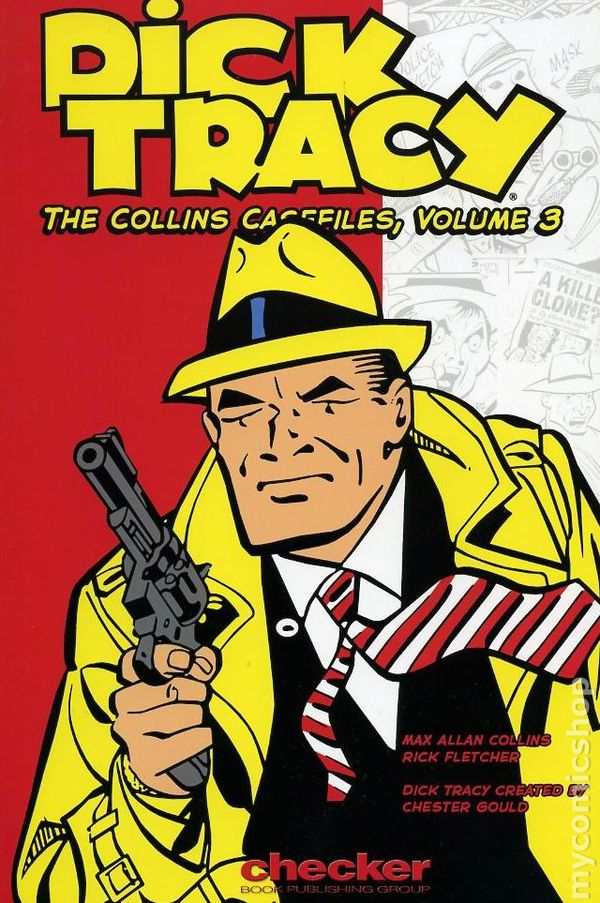Il sera ici question d'Art Spiegelman, auteur américain d'origine suédoise, figure emblématique du la bande dessinée underground des années 70-80 (qui a dit "punk"?) et dont on considère le Maus, édité entre 1986 et 1991 et dédié à son père survivant de l'Holocauste, comme rien moins que la meilleure BD du monde (multi-primée, avec même carrément le Pulitzer 1992).
vendredi 1 décembre 2017
Storytelling avec... Art Spiegelman par The Nerdwriter
Où je vais mélanger ma propre rubrique analytique avec les random works of wow, puisque l'explication du jour n'est justement pas la mienne, mais celle du Nerdwriter, un youtuber qui, comme son nom l'indique, s'est fait une spécialité de décortiquer les médias narratifs, et dont j'avais déjà posté une vidéo, à propos des serials.
Il sera ici question d'Art Spiegelman, auteur américain d'origine suédoise, figure emblématique du la bande dessinée underground des années 70-80 (qui a dit "punk"?) et dont on considère le Maus, édité entre 1986 et 1991 et dédié à son père survivant de l'Holocauste, comme rien moins que la meilleure BD du monde (multi-primée, avec même carrément le Pulitzer 1992).
Il sera ici question d'Art Spiegelman, auteur américain d'origine suédoise, figure emblématique du la bande dessinée underground des années 70-80 (qui a dit "punk"?) et dont on considère le Maus, édité entre 1986 et 1991 et dédié à son père survivant de l'Holocauste, comme rien moins que la meilleure BD du monde (multi-primée, avec même carrément le Pulitzer 1992).
lundi 6 novembre 2017
Tolkien, Anderson et la Haute Fantasy (et Beowulf, aussi)
Relisant quelques vieux trucs au hasard du web et cherchant en vain à me procurer une version numérique de la dernière transcription de Beowulf (par Stephen Mitchell, aux presses de l'université de Yale), je me faisais cette remarque : il est souvent question de ce que Tolkien a inventé et apporté au genre fantasy, mais jamais on n'aborde réellement l'époque à laquelle a été écrit Le Seigneur des anneaux.
Il faut savoir qu'en 1954 sortent deux livres majeurs dans la construction de la fantasy moderne : Le Seigneur des anneaux, donc, et L'Epée brisée de Poul Anderson.
Anderson est un auteur américain bien plus connu pour ses travaux en science-fiction (il est l'un des pères fondateurs de la SF dite "dure"), mais il est aussi l'auteur de deux livres qui seront d'extrême importance pour la fantasy en tant que genre : L'Epée brisée et Trois coeurs, trois lions. Le second date de 1961 et je n'en parlerai pas ici, mais il reprend une nouvelle écrite en 1953 qui portait les gènes de ce que sera L'Epée brisée.
L'Epée brisée est une saga nordique dans la plus pure tradition des textes de l'Edda, c'est un récit épique et froid, profondément fataliste où, comme de rigueur dans la mythologie nordique, tout le monde meurt à la fin (et ne venez pas me parler de spoilers, on est dans un genre dont c'est le principe, et sur un livre vieux de plus d'un demi-siècle, y a prescription). C'est aussi un livre depuis largement, quoique souvent involontairement, absorbé par la culture populaire, et dont ressortiront de nombreux principes de Donjons & Dragons, notamment la classe du Berserker (incidemment, le Paladin est lui le héros prototypé par Holger dans Trois coeurs, trois lions). Mais surtout, c'est une histoire curieusement proche de celle du Seigneur des anneaux. Pas de breloque dorée, néanmoins, le noeud de l'histoire est ici l'épée, brisée comme son nom l'indique, qui est offerte au héros le jour de son baptême chez les Elfes. Ceux-ci sont des êtres hautains et millénaires qui n'aiment rien tant que de tisser les intrigues les plus retorses (comme voler des enfants humains pour les remplacer par des changelins) et se battre contre les Trolls. Reforger l'arme est bien évidemment le point central de toute la quête, et au dessus de ce petit monde qui tourne en rond, Dieux, Ases et Forces immatérielles observent et jouent avec les destinés de chacun.
Une saga nordique, quoi.
Anderson a toutefois l'idée originale d'entremêler les panthéons. Les êtres magiques ont ainsi une frousse bleue du Dieu des hommes chrétiens et du Christ Blanc (la simple vue d'une croix ou la profération d'un blasphème/prière leur est insupportable), et même les Ases, pourtant si joueurs, se gardent bien d'aller embêter les brebis du Berger.
C'est évidemment en bouleversant un peu l'ordre établi que l'action de L'Epée brisée peut avoir lieu, et l'issue d'un tel chambardement ne peut être que funeste. Pas de voyage vers Valinor, ici. Valhöll, peut-être...
Si les deux histoires, tant par leur sujet que par leur longueur (L'Epée brisée atteint péniblement les trois cent pages), sont tout à fait opposées, il faudrait être aveugle pour ne pas en voir les points communs. Le plus prégnant étant bien évidemment ce qu'on considère comme le récit fondateur de la fiction anglophone : Beowulf. N'oublions pas que Tolkien s'est illustré entre 1933 et 1937 pour une traduction en prose du poème et son adaptation en conte de fée : Le Hobbit.
Et c'est là où je veux en venir en vous parlant de cet "autre livre fondateur".
Dans l'Avant-Guerre, la fantasy, naissante, se cherchait un univers. Elle était allé le chercher dans le contexte économique et scientifique de son époque, un nouveau siècle où l'ont a digéré l'industrialisation et dont les possibilités semblent infinies. Dans les étoiles, par exemple, avec notamment des épopées comme celle de John Carter (faut-il que je vous rappelle la fixation qu'ont les années 1900 avec Mars ?), et les voyages aux confins du monde, comme, chez le même auteur, la cité d'Opar ou Pellucidar. La Première Guerre a (r)ouvert les portes du moyen orient aux explorateurs occidentaux (Lawrence d'Arabie, quelqu'un ?), et la découverte des vestiges sumériens, la réappropriation d'un imaginaire égyptien ou les longues étendues désertiques du croissant fertile ont essaimé les esprits des premiers grands maîtres du genre, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft et Clark Ashton Smith (est-il réellement nécessaire que je vous présente ces trois-là ?) créant des mondes de barbarie et d'effroi, de mythes quasi-bibliques, et une fiction qu'on n'hésitera pas à qualifier d'ésotérique.
...Ou du moins, c'est ce dont on se souvient, aujourd'hui, inondé que nous le sommes depuis les années soixante par la littérature américaine.
Si l'on remonte un peu plus loin, la fin du XIXeme siècle britannique fut propice à la littérature fantasy - qui ne portait alors pas ce nom et qu'on relia à un sous-genre de la science-fiction jusqu'à ce que Fritz Leiber crée le terme "sword & sorcery" en 1961. Si l'on place souvent le terreau de ce qu'écriront Burroughs et Howard dans les cités perdues d'Henry Rider Haggard (She, Les Mines d'or du roi Salomon), le nom moins systématique de William Morris vous dit peut-être quelque chose, de même que celui de Lord Dunsany.
Ces deux gentilhommes sont la matrice du genre, des auteurs de récits étranges se déroulant dans d'autres mondes, qu'il fussent visités par des gens bien des chez nous (Dunsany se fera un plaisir d'envoyer un avatar de lui-même sur une planète médiévale-fantastique, idée que reprendra, vous aurez fait la corrélation vous-même, Une Princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs, mais aussi Abraham Merritt dans ce qu'on considère comme l'un des premiers vrais grands récits de fantasy, La Nef d'Ishtar) ou pleinement autocontenus.
Le contexte y est médiéval, Arthurien presque, mais évolue vite. Le fait est que, fin XIXème et début XXème confondus, deux influences sont particulièrement prégnantes dans la littérature fantasy et expliquent les incroyables similitudes entre les sujets d'Anderson et Tolkien cinquante ans plus tard.
Tout d'abord, la fin du siècle de l'industrialisation voit naître la théorie aryenne (à ne pas confondre avec l'arianisme, théologie chrétienne du quatrième siècle) suite à la redécouverte de vestiges viking et à de nouvelles (contre-)études sur le berceau des peuples indo-européens. Cette théorie, qui entend prouver la supériorité des descendants de race nordique (et on parle bien là de recherches anthropologiques dans le contexte scientifique racial de l'époque, ne vous arrêtez pas au spectre hitlerien), fut très vite contestée, et largement démentie, car perclue de paradoxes morphologiques, linguistiques et civilisationels. Seulement démentir une théorie ne suffit pas à la rendre impopulaire et de nombreux penseurs et auteurs y adhérèrent, dans l'ancien comme au nouveau monde, à l'image -tiens, tiens- d'Howard et Lovecraft, expliquant la toute-puissance du mâle caucasien -au sens propre chez Howard, son Conan étant un Cimmérien, un habitant de l'Ukraine antique- dans leur littérature.
L'autre, c'est Beowulf, qui va faire à la fin du XIXème une entrée fracassante dans les inspirations littéraires. Il faut dire que, si l'on sait retracer l'histoire de la dernière copie (plus ou moins) d'époque en notre possession (le fameux Codex Nowell) à un noble anglais du XVIIème siècle, la première transcription du manuscrit ne se fera qu'en 1815, sous l'impulsion du gouvernement danois (ce qui donnera lieu a une certaine réticence vis-à-vis du texte produit, mais c'est une histoire pour un autre post). Les premières adaptations publiées à destination du grand public, elles, apparaîtront au cours des années 1880-90.
Tout cela ouvre bien facilement les portes d'un culte du guerrier nordique dans les mondes fantastiques, et une redécouverte par bien des auteurs anglo-saxons de leurs origines scandinaves. Réinterpréter un pan de littérature fictionnelle à l'aune de nouvelles découvertes archéologiques et de nouveaux idéaux, aussi caduques qu'ils soient, se fait naturellement... Et les mythes septentrionaux d'envahir la fantasy comme les vikings la côte anglaise.
Quoi de plus logique, alors, que vingt/trente ans plus tard, Elfes, Trolls et Hommes se disputent des mondes imaginaires dans un conflit magique qui perdure jusqu'à aujourd'hui sous le nom de "haute fantasy" ? On imagine facilement pourquoi, d'ascendance danoise, Poul Anderson s'est tourné vers la saga pure et dure, là où l'universitaire qu'était Tolkien chercha la construction d'une mythologie et des peuples qui en découlent (un travail qu'il débute, alors étudiant, dès la fin des années 1910). Il est aussi intéressant de noter que tout deux y conserveront un savant filtre chrétien (Beowulf est un poème pieux) pour expliquer la création de leurs univers (les elfes n'ont pas d'âme, Gandalf est un ange,...).
C'est aussi à cette période qu'on se rend compte, dans les domaines de l'édition, qu'il faut un nom à cette fiction pseudo-médiévale d'un genre nouveau. Elle restait éminemment fantastique, mais avait fini par développer ses propres principes et clichés, s'éloignant tant du roman historique que de celui de la fiction spéculative (alias touche-à-tout de la science-fiction), et une entité éditoriale maniant son propre vocabulaire, ça s'appelle un genre, et ça a besoin d'un nom. Et comme sa grande soeur SF, la fantasy en a eu des tonnes.
En France, se basant sur les chansons de geste d'antan, on a beaucoup parlé "d'épopée fantastique" (ce fut même le nom d'une série de recueil dans la collection Livre d'or de la SF chez Pocket), les américains utilisent sword & sorcery, et je suis bien incapable de vous dire exactement d'où sort le mot "fantasy" pour désigner le genre. Toujours est-il qu'on a fini par l'adopter uniformément selon les langues car il permettait de plus facilement se découper. Science-fantasy, heroic fantasy, high fantasy, dark fantasy, on en a vu des douzaines s'entrecroiser et s'entredécouper, et ça, on le doit à l'ébullition créée au début des années cinquante (Fritz Leiber atteint enfin la reconnaissance avec Fafhrd et le Souricier Gris, C.S. Lewis crée des mondes dans des penderies et Lyon Sprague de Camp imite déjà Howard en débutant son cycle pusadien -inédit en français, ne cherchez pas après-).
C'est pour ça qu'il est très important de replacer Tolkien en contexte. La fantasy en tant que telle existe depuis déjà bien longtemps quand Le Hobbit sort en 1937, alors pensez si Le Seigneur des anneaux apporte quoi que ce soit, formellement parlant. Le vrai tour de force de cette trilogie, c'est d'avoir aidé à sortir un genre mineur de son ornière sous-genresque et d'en avoir fait un élément à part entière de la littérature fantastique (sachant que la fantasy n'aura réellement de succès populaire qu'une décennie plus tard, quand Lloyd Alexander, Michael Moorcock ou Ursula Le Guin, jeunes auteurs qui ont, justement, lu Tolkien et Anderson, entreront en scène). La période était rêvée : dès 1950, un travail éditorial faramineux avait remis Conan sur le devant de la scène (note aux puristes : non, Lyon Sprague de Camp n'est pas encore entré dans la danse) et lui offrait, tardivement, la reconnaissance que le format pulp n'aurait pu lui permettre, T.H. Lewis publiait le quatrième volume de son cycle arthurien (qui donnera la source du Merlin l'enchanteur de Disney), et de nombreux auteurs et éditeurs s'engouffrèrent dans la brèche. Loin de moi l'idée de qualifier Tolkien ou Anderson de suiveurs, bien au contraire, mais leurs influences sont claires et le fait qu'ils sortent leurs livres à cette époque n'est pas le fruit du hasard.
Ce qui l'est, en revanche, c'est Le Seigneur des anneaux en lui-même. Tolkien avait bien un contrat pour signer une suite du Hobbit, il travaillait bien sur ce projet de "Terre du Milieu" depuis les années 1920, mais il faut bien comprendre que c'est un universitaire. Il a écrit Le Hobbit presque par hasard, pour ses enfants, son univers est avant tout un outil de travail, d'expérimentation, Le Seigneur des anneaux est écrit comme un réel support à l'Histoire (oui, avec un grand H) de la Terre du Milieu, pas comme un roman de genre. Tolkien lui-même disait qu'il l'avait surtout rédigé pour mettre en valeur la langue elfique qu'il avait inventé et, quoiqu'on puisse facilement imaginer qu'il y ait dans cette déclaration beaucoup de cynisme (oserais-je dire un troll ?), ça met la chose en perspective. Narrativement, on est souvent très en dessous des standards de l'époque, ce qui sera souvent reproché à Tolkien d'ailleurs, mais son monde est tellement foisonnant qu'il trouve le moyen d'embarquer le lecteur malgré tout le mal qu'il est susceptible de dire de sa prose. Ce monde est à la fois le point fort (en terme d'environnement) et le point faible (en terme purement littéraire) de la trilogie, et la raison, je pense, pour laquelle on n'a eu que ces quatre livres du vivant de leur auteur. Je doute que les textes qui forment le Silmarillion aient été initialement prévu pour l'édition, les retouches de Christopher Tolkien y sont nombreuses (au moins autant que les annotations) et la plupart des autres textes (en et hors-Terre du Milieu) publiés à titre posthume sont des histoires courtes, souvent proches du conte. Loin, en vérité, de ce qu'on imaginerait d'un auteur qui aurait révolutionné la fantasy.
L'histoire éditoriale d'un livre est bien souvent totalement indépendante du travail de son auteur, et l'évolution du Seigneur des anneaux dans le temps, de ses faibles ventes initiales à son adaptation hollywoodienne multimilliardaire, de sa vision de pamphlet anti-Geurre Froide chez les Hippies à son statut actuel d'objet de travail chez d'innombrables chercheurs en littérature, c'est quasi miraculeux...
Ainsi donc, alors qu'à la sortie de L'Epée brisée on ignore plus ou moins volontairement un jeune auteur novice (né en 1926, Anderson a publié son premier roman en 1952), Le Seigneur des anneaux va être un four, un échec critique et littéraire quasi-unanime : Le Hobbit, s'il était la seule fiction de Tolkien (en dehors de quelques études, il n'avait rien publié d'autre), avait connu un fort succès à sa sortie, tant sur le territoire britannique qu'aux Etats-Unis, et une suite avait été contractée et était attendue depuis au moins 1938 (du moins pour ceux qui s'en souvenaient, car le livre avait disparu des étals et n'avait pas été réédité depuis 1942). Trop longue, trop compliquée, trop alambiquée, la trilogie des Anneaux recevra un accueil très froid de la critique, qui lui reprochera un style lourdaud et le manque de résolution d'une intrigue qui semble ne pas savoir où elle va. Il lui faudra dix ans et une publication au format poche aux Etats-Unis pour s'imposer, avec une compréhension très différente de sa quête, on vient de le voir, par les contre-cultures des années 60.
En France, la réception fut justement le principal problème de Poul Anderson, et la raison unique de son manque totale de (re)connaissance par chez nous : écrivain réactionnaire WASP, le dano-américain était très mal vu des éditeurs français des années soixante pour ses idéaux à peine masqués dans un pays fraîchement laïque (Constitution de 1958). Il a fallu attendre le début des années 2000 et un tout nouveau siècle pour qu'on cesse de s'arrêter aux idées de l'homme et qu'on s'attache au travail de l'auteur, et, de fait, qu'on mette l'époque en perspective.
Tolkien mérite amplement sa place à la postérité, n'allez pas me comprendre de travers ; si la littérature de fantasy à l'heure actuelle est à ce point engluée dans la manie du cycle in(dé)fini, si vingt ans après la publication des livres on en faisait des mods de wargames qui donneraient naissance aux jeux de rôle, s'il a fallu des décennies avant qu'un taré néo-zélandais ose les transformer en oeuvres cinématographiques (oui, je sais, y a eu Ralph Bakshi, aussi), ce n'est pas pour rien. Mais, contrairement à son Anneau, Tolkien n'est pas Unique. Il y a une période, un contexte qui explique sa littérature, et des idées et idéaux partagés. Et si la renommée à l'international du professeur d'Oxford a fait de lui l'inévitable référence, dans le monde anglo-saxon, Poul Anderson, auteur versatile s'il en est, est l'autre jalon incontesté de l'épopée fantastique. Demandez à Michael Moorcock...
Il faut savoir qu'en 1954 sortent deux livres majeurs dans la construction de la fantasy moderne : Le Seigneur des anneaux, donc, et L'Epée brisée de Poul Anderson.
Anderson est un auteur américain bien plus connu pour ses travaux en science-fiction (il est l'un des pères fondateurs de la SF dite "dure"), mais il est aussi l'auteur de deux livres qui seront d'extrême importance pour la fantasy en tant que genre : L'Epée brisée et Trois coeurs, trois lions. Le second date de 1961 et je n'en parlerai pas ici, mais il reprend une nouvelle écrite en 1953 qui portait les gènes de ce que sera L'Epée brisée.
L'Epée brisée est une saga nordique dans la plus pure tradition des textes de l'Edda, c'est un récit épique et froid, profondément fataliste où, comme de rigueur dans la mythologie nordique, tout le monde meurt à la fin (et ne venez pas me parler de spoilers, on est dans un genre dont c'est le principe, et sur un livre vieux de plus d'un demi-siècle, y a prescription). C'est aussi un livre depuis largement, quoique souvent involontairement, absorbé par la culture populaire, et dont ressortiront de nombreux principes de Donjons & Dragons, notamment la classe du Berserker (incidemment, le Paladin est lui le héros prototypé par Holger dans Trois coeurs, trois lions). Mais surtout, c'est une histoire curieusement proche de celle du Seigneur des anneaux. Pas de breloque dorée, néanmoins, le noeud de l'histoire est ici l'épée, brisée comme son nom l'indique, qui est offerte au héros le jour de son baptême chez les Elfes. Ceux-ci sont des êtres hautains et millénaires qui n'aiment rien tant que de tisser les intrigues les plus retorses (comme voler des enfants humains pour les remplacer par des changelins) et se battre contre les Trolls. Reforger l'arme est bien évidemment le point central de toute la quête, et au dessus de ce petit monde qui tourne en rond, Dieux, Ases et Forces immatérielles observent et jouent avec les destinés de chacun.
Une saga nordique, quoi.
Anderson a toutefois l'idée originale d'entremêler les panthéons. Les êtres magiques ont ainsi une frousse bleue du Dieu des hommes chrétiens et du Christ Blanc (la simple vue d'une croix ou la profération d'un blasphème/prière leur est insupportable), et même les Ases, pourtant si joueurs, se gardent bien d'aller embêter les brebis du Berger.
C'est évidemment en bouleversant un peu l'ordre établi que l'action de L'Epée brisée peut avoir lieu, et l'issue d'un tel chambardement ne peut être que funeste. Pas de voyage vers Valinor, ici. Valhöll, peut-être...
Si les deux histoires, tant par leur sujet que par leur longueur (L'Epée brisée atteint péniblement les trois cent pages), sont tout à fait opposées, il faudrait être aveugle pour ne pas en voir les points communs. Le plus prégnant étant bien évidemment ce qu'on considère comme le récit fondateur de la fiction anglophone : Beowulf. N'oublions pas que Tolkien s'est illustré entre 1933 et 1937 pour une traduction en prose du poème et son adaptation en conte de fée : Le Hobbit.
Et c'est là où je veux en venir en vous parlant de cet "autre livre fondateur".
Dans l'Avant-Guerre, la fantasy, naissante, se cherchait un univers. Elle était allé le chercher dans le contexte économique et scientifique de son époque, un nouveau siècle où l'ont a digéré l'industrialisation et dont les possibilités semblent infinies. Dans les étoiles, par exemple, avec notamment des épopées comme celle de John Carter (faut-il que je vous rappelle la fixation qu'ont les années 1900 avec Mars ?), et les voyages aux confins du monde, comme, chez le même auteur, la cité d'Opar ou Pellucidar. La Première Guerre a (r)ouvert les portes du moyen orient aux explorateurs occidentaux (Lawrence d'Arabie, quelqu'un ?), et la découverte des vestiges sumériens, la réappropriation d'un imaginaire égyptien ou les longues étendues désertiques du croissant fertile ont essaimé les esprits des premiers grands maîtres du genre, Robert E. Howard, H.P. Lovecraft et Clark Ashton Smith (est-il réellement nécessaire que je vous présente ces trois-là ?) créant des mondes de barbarie et d'effroi, de mythes quasi-bibliques, et une fiction qu'on n'hésitera pas à qualifier d'ésotérique.
...Ou du moins, c'est ce dont on se souvient, aujourd'hui, inondé que nous le sommes depuis les années soixante par la littérature américaine.
Si l'on remonte un peu plus loin, la fin du XIXeme siècle britannique fut propice à la littérature fantasy - qui ne portait alors pas ce nom et qu'on relia à un sous-genre de la science-fiction jusqu'à ce que Fritz Leiber crée le terme "sword & sorcery" en 1961. Si l'on place souvent le terreau de ce qu'écriront Burroughs et Howard dans les cités perdues d'Henry Rider Haggard (She, Les Mines d'or du roi Salomon), le nom moins systématique de William Morris vous dit peut-être quelque chose, de même que celui de Lord Dunsany.
Ces deux gentilhommes sont la matrice du genre, des auteurs de récits étranges se déroulant dans d'autres mondes, qu'il fussent visités par des gens bien des chez nous (Dunsany se fera un plaisir d'envoyer un avatar de lui-même sur une planète médiévale-fantastique, idée que reprendra, vous aurez fait la corrélation vous-même, Une Princesse de Mars d'Edgar Rice Burroughs, mais aussi Abraham Merritt dans ce qu'on considère comme l'un des premiers vrais grands récits de fantasy, La Nef d'Ishtar) ou pleinement autocontenus.
Le contexte y est médiéval, Arthurien presque, mais évolue vite. Le fait est que, fin XIXème et début XXème confondus, deux influences sont particulièrement prégnantes dans la littérature fantasy et expliquent les incroyables similitudes entre les sujets d'Anderson et Tolkien cinquante ans plus tard.
Tout d'abord, la fin du siècle de l'industrialisation voit naître la théorie aryenne (à ne pas confondre avec l'arianisme, théologie chrétienne du quatrième siècle) suite à la redécouverte de vestiges viking et à de nouvelles (contre-)études sur le berceau des peuples indo-européens. Cette théorie, qui entend prouver la supériorité des descendants de race nordique (et on parle bien là de recherches anthropologiques dans le contexte scientifique racial de l'époque, ne vous arrêtez pas au spectre hitlerien), fut très vite contestée, et largement démentie, car perclue de paradoxes morphologiques, linguistiques et civilisationels. Seulement démentir une théorie ne suffit pas à la rendre impopulaire et de nombreux penseurs et auteurs y adhérèrent, dans l'ancien comme au nouveau monde, à l'image -tiens, tiens- d'Howard et Lovecraft, expliquant la toute-puissance du mâle caucasien -au sens propre chez Howard, son Conan étant un Cimmérien, un habitant de l'Ukraine antique- dans leur littérature.
L'autre, c'est Beowulf, qui va faire à la fin du XIXème une entrée fracassante dans les inspirations littéraires. Il faut dire que, si l'on sait retracer l'histoire de la dernière copie (plus ou moins) d'époque en notre possession (le fameux Codex Nowell) à un noble anglais du XVIIème siècle, la première transcription du manuscrit ne se fera qu'en 1815, sous l'impulsion du gouvernement danois (ce qui donnera lieu a une certaine réticence vis-à-vis du texte produit, mais c'est une histoire pour un autre post). Les premières adaptations publiées à destination du grand public, elles, apparaîtront au cours des années 1880-90.
Tout cela ouvre bien facilement les portes d'un culte du guerrier nordique dans les mondes fantastiques, et une redécouverte par bien des auteurs anglo-saxons de leurs origines scandinaves. Réinterpréter un pan de littérature fictionnelle à l'aune de nouvelles découvertes archéologiques et de nouveaux idéaux, aussi caduques qu'ils soient, se fait naturellement... Et les mythes septentrionaux d'envahir la fantasy comme les vikings la côte anglaise.
Quoi de plus logique, alors, que vingt/trente ans plus tard, Elfes, Trolls et Hommes se disputent des mondes imaginaires dans un conflit magique qui perdure jusqu'à aujourd'hui sous le nom de "haute fantasy" ? On imagine facilement pourquoi, d'ascendance danoise, Poul Anderson s'est tourné vers la saga pure et dure, là où l'universitaire qu'était Tolkien chercha la construction d'une mythologie et des peuples qui en découlent (un travail qu'il débute, alors étudiant, dès la fin des années 1910). Il est aussi intéressant de noter que tout deux y conserveront un savant filtre chrétien (Beowulf est un poème pieux) pour expliquer la création de leurs univers (les elfes n'ont pas d'âme, Gandalf est un ange,...).
C'est aussi à cette période qu'on se rend compte, dans les domaines de l'édition, qu'il faut un nom à cette fiction pseudo-médiévale d'un genre nouveau. Elle restait éminemment fantastique, mais avait fini par développer ses propres principes et clichés, s'éloignant tant du roman historique que de celui de la fiction spéculative (alias touche-à-tout de la science-fiction), et une entité éditoriale maniant son propre vocabulaire, ça s'appelle un genre, et ça a besoin d'un nom. Et comme sa grande soeur SF, la fantasy en a eu des tonnes.
En France, se basant sur les chansons de geste d'antan, on a beaucoup parlé "d'épopée fantastique" (ce fut même le nom d'une série de recueil dans la collection Livre d'or de la SF chez Pocket), les américains utilisent sword & sorcery, et je suis bien incapable de vous dire exactement d'où sort le mot "fantasy" pour désigner le genre. Toujours est-il qu'on a fini par l'adopter uniformément selon les langues car il permettait de plus facilement se découper. Science-fantasy, heroic fantasy, high fantasy, dark fantasy, on en a vu des douzaines s'entrecroiser et s'entredécouper, et ça, on le doit à l'ébullition créée au début des années cinquante (Fritz Leiber atteint enfin la reconnaissance avec Fafhrd et le Souricier Gris, C.S. Lewis crée des mondes dans des penderies et Lyon Sprague de Camp imite déjà Howard en débutant son cycle pusadien -inédit en français, ne cherchez pas après-).
C'est pour ça qu'il est très important de replacer Tolkien en contexte. La fantasy en tant que telle existe depuis déjà bien longtemps quand Le Hobbit sort en 1937, alors pensez si Le Seigneur des anneaux apporte quoi que ce soit, formellement parlant. Le vrai tour de force de cette trilogie, c'est d'avoir aidé à sortir un genre mineur de son ornière sous-genresque et d'en avoir fait un élément à part entière de la littérature fantastique (sachant que la fantasy n'aura réellement de succès populaire qu'une décennie plus tard, quand Lloyd Alexander, Michael Moorcock ou Ursula Le Guin, jeunes auteurs qui ont, justement, lu Tolkien et Anderson, entreront en scène). La période était rêvée : dès 1950, un travail éditorial faramineux avait remis Conan sur le devant de la scène (note aux puristes : non, Lyon Sprague de Camp n'est pas encore entré dans la danse) et lui offrait, tardivement, la reconnaissance que le format pulp n'aurait pu lui permettre, T.H. Lewis publiait le quatrième volume de son cycle arthurien (qui donnera la source du Merlin l'enchanteur de Disney), et de nombreux auteurs et éditeurs s'engouffrèrent dans la brèche. Loin de moi l'idée de qualifier Tolkien ou Anderson de suiveurs, bien au contraire, mais leurs influences sont claires et le fait qu'ils sortent leurs livres à cette époque n'est pas le fruit du hasard.
Ce qui l'est, en revanche, c'est Le Seigneur des anneaux en lui-même. Tolkien avait bien un contrat pour signer une suite du Hobbit, il travaillait bien sur ce projet de "Terre du Milieu" depuis les années 1920, mais il faut bien comprendre que c'est un universitaire. Il a écrit Le Hobbit presque par hasard, pour ses enfants, son univers est avant tout un outil de travail, d'expérimentation, Le Seigneur des anneaux est écrit comme un réel support à l'Histoire (oui, avec un grand H) de la Terre du Milieu, pas comme un roman de genre. Tolkien lui-même disait qu'il l'avait surtout rédigé pour mettre en valeur la langue elfique qu'il avait inventé et, quoiqu'on puisse facilement imaginer qu'il y ait dans cette déclaration beaucoup de cynisme (oserais-je dire un troll ?), ça met la chose en perspective. Narrativement, on est souvent très en dessous des standards de l'époque, ce qui sera souvent reproché à Tolkien d'ailleurs, mais son monde est tellement foisonnant qu'il trouve le moyen d'embarquer le lecteur malgré tout le mal qu'il est susceptible de dire de sa prose. Ce monde est à la fois le point fort (en terme d'environnement) et le point faible (en terme purement littéraire) de la trilogie, et la raison, je pense, pour laquelle on n'a eu que ces quatre livres du vivant de leur auteur. Je doute que les textes qui forment le Silmarillion aient été initialement prévu pour l'édition, les retouches de Christopher Tolkien y sont nombreuses (au moins autant que les annotations) et la plupart des autres textes (en et hors-Terre du Milieu) publiés à titre posthume sont des histoires courtes, souvent proches du conte. Loin, en vérité, de ce qu'on imaginerait d'un auteur qui aurait révolutionné la fantasy.
L'histoire éditoriale d'un livre est bien souvent totalement indépendante du travail de son auteur, et l'évolution du Seigneur des anneaux dans le temps, de ses faibles ventes initiales à son adaptation hollywoodienne multimilliardaire, de sa vision de pamphlet anti-Geurre Froide chez les Hippies à son statut actuel d'objet de travail chez d'innombrables chercheurs en littérature, c'est quasi miraculeux...
Ainsi donc, alors qu'à la sortie de L'Epée brisée on ignore plus ou moins volontairement un jeune auteur novice (né en 1926, Anderson a publié son premier roman en 1952), Le Seigneur des anneaux va être un four, un échec critique et littéraire quasi-unanime : Le Hobbit, s'il était la seule fiction de Tolkien (en dehors de quelques études, il n'avait rien publié d'autre), avait connu un fort succès à sa sortie, tant sur le territoire britannique qu'aux Etats-Unis, et une suite avait été contractée et était attendue depuis au moins 1938 (du moins pour ceux qui s'en souvenaient, car le livre avait disparu des étals et n'avait pas été réédité depuis 1942). Trop longue, trop compliquée, trop alambiquée, la trilogie des Anneaux recevra un accueil très froid de la critique, qui lui reprochera un style lourdaud et le manque de résolution d'une intrigue qui semble ne pas savoir où elle va. Il lui faudra dix ans et une publication au format poche aux Etats-Unis pour s'imposer, avec une compréhension très différente de sa quête, on vient de le voir, par les contre-cultures des années 60.
En France, la réception fut justement le principal problème de Poul Anderson, et la raison unique de son manque totale de (re)connaissance par chez nous : écrivain réactionnaire WASP, le dano-américain était très mal vu des éditeurs français des années soixante pour ses idéaux à peine masqués dans un pays fraîchement laïque (Constitution de 1958). Il a fallu attendre le début des années 2000 et un tout nouveau siècle pour qu'on cesse de s'arrêter aux idées de l'homme et qu'on s'attache au travail de l'auteur, et, de fait, qu'on mette l'époque en perspective.
Tolkien mérite amplement sa place à la postérité, n'allez pas me comprendre de travers ; si la littérature de fantasy à l'heure actuelle est à ce point engluée dans la manie du cycle in(dé)fini, si vingt ans après la publication des livres on en faisait des mods de wargames qui donneraient naissance aux jeux de rôle, s'il a fallu des décennies avant qu'un taré néo-zélandais ose les transformer en oeuvres cinématographiques (oui, je sais, y a eu Ralph Bakshi, aussi), ce n'est pas pour rien. Mais, contrairement à son Anneau, Tolkien n'est pas Unique. Il y a une période, un contexte qui explique sa littérature, et des idées et idéaux partagés. Et si la renommée à l'international du professeur d'Oxford a fait de lui l'inévitable référence, dans le monde anglo-saxon, Poul Anderson, auteur versatile s'il en est, est l'autre jalon incontesté de l'épopée fantastique. Demandez à Michael Moorcock...
mercredi 11 octobre 2017
Serials noirs : coffret Blu-Ray/DVD dédié à Louis Feuillade
J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer son nom, Louis Feuillade est probablement le réalisateur du muet en France, avec environ soixante-dix films et plus de cent cinquante épisodes de séries sur une carrière dune vingtaine d'années. Ses oeuvres majeures, Fantômas et Les Vampires (auxquelles on doit des milliards d'influences pulp, du Shadow à Catwoman) viennent ce jour de se retrouver compilées, annotées, restaurées et complétées d'une myriade de bonus dans une édition dantesque signée Gaumont.
C'est dans trois mois, mais vous pouvez d'ores et déjà ajouter ça sur votre liste des cadeaux de Noël, et soyez certains que j'en reparlerai prochainement.
EDIT :
En attendant ledit reparlage, Critikat en a fait une présentation plutôt intéressante (que je ne m'aventurerai pas à appeler "critique"), de quoi guider les indécis qui ne savent trop à quoi s'attendre.
C'est dans trois mois, mais vous pouvez d'ores et déjà ajouter ça sur votre liste des cadeaux de Noël, et soyez certains que j'en reparlerai prochainement.
EDIT :
En attendant ledit reparlage, Critikat en a fait une présentation plutôt intéressante (que je ne m'aventurerai pas à appeler "critique"), de quoi guider les indécis qui ne savent trop à quoi s'attendre.
lundi 2 octobre 2017
Il viendra des pluies douces
There will come soft rains and the smell of the ground,
And swallows circling with their shimmering sound;
And frogs in the pools singing at night,
And wild plum-trees in tremulous white;
Robins will wear their feathery fire
Whistling their whims on a low fence-wire;
And not one will know of the war, not one
Will care at last when it is done.
Not one would mind, neither bird nor tree
If mankind perished utterly;
And Spring herself, when she woke at dawn,
Would scarcely know that we were gone.
Ce poème de Sara Teasdale, There Will Come Soft Rains, jamais traduit en français, vous est probablement inconnu. En tout cas, il me l'était, jusqu'à ce que ce matin, je lise un peu par hasard un article de LitReactor comparant la nouvelle du même titre de Ray Bradbury au Blade Runner cinématographique.
Je ne reviendrai pas sur le contenu de l'article, ça ne m'intéresse pas ici, mais sur la nouvelle, que j'avais elle aussi oubliée et qui, à la relecture (dans Les Chroniques martiennes), est peut-être bien l'une des plus mélancoliques (et terrifiantes) jamais écrites par Bradbury :
Au matin du 8 avril 1985 (ou 4 août 2026 selon les éditions), une maison de la côte californienne s'affaire, réchauffant son atmosphère, préparant le petit déjeuner et réveillant ses occupants... absents. Peu à peu, il devient clair que la maison est l'une des dernières debout près un cataclysme nucléaire, quand soudain, un magnétophone s'allume et récite le poème. Ce soir là, une tempête envoie une branche dans une des fenêtres de la maison, qui renverse un liquide de ménage sur le poêle, provocant un incendie. Seul un mur survivra, celui sur lequel sont imprimées les silhouettes, brûlées par l'explosion atomique des années auparavant, de ses anciens occupants.
Si la nouvelle vient d'un courant science-fictionnel post-atomique et permet une lecture tout à fait imagée du poème, il est cependant intéressant de noter que ce dernier date de 1918, à une période où le spectre de la Grande Guerre est aussi palpable en Amérique que chez nous, mais où il était rare d'évoquer l'extinction de l'espèce humaine par la guerre - il faudra, justement, attendre la Bombe pour ça, vingt-cinq ans plus tard.
Et si tout cela ne vous parait pas assez lugubre, l'Ouzbékistan communiste en a tiré un glaçant court-métrage en 1984.
Quant à l'illustration, elle vient de son adaptation en bande dessinée par Wally Wood, dans le numéro 17 de Weird Fantasy (1953) chez EC Comics.
lundi 26 juin 2017
Random work of wow : Les voyages de Conan
Amis cartographes, ceci pourrait émoustiller les plus pulp d'entre-vous : un fou sur Deviantart a réalisé une série de cartes détaillant les nombreux voyages du cimmérien selon différentes chronologies, prenant en compte différentes publications.
Je vous poste ici celle réalisée d'après The Dark Storm Conan Chronology de Dale Rippke, probablement la plus complète, mais vous trouverez aussi des versions adaptées de l'essai A Probable Outline of Conan's Career de P. Schuyler Miller et John D. Clark (publié en 1936 et qui ne compte en toute logique que les histoires de Conan publiées du vivant d'Howard), et celle de Joe Marek, une révision de la Miller & Clark à la temporalité légèrement différente.
J'aurais bien aimé y trouver celle de Robert Jordan, qui comptabilise tous les récits apocryphes des années 70-80, mais le but avoué était de se limiter aux textes originaux.
Je vous poste ici celle réalisée d'après The Dark Storm Conan Chronology de Dale Rippke, probablement la plus complète, mais vous trouverez aussi des versions adaptées de l'essai A Probable Outline of Conan's Career de P. Schuyler Miller et John D. Clark (publié en 1936 et qui ne compte en toute logique que les histoires de Conan publiées du vivant d'Howard), et celle de Joe Marek, une révision de la Miller & Clark à la temporalité légèrement différente.
J'aurais bien aimé y trouver celle de Robert Jordan, qui comptabilise tous les récits apocryphes des années 70-80, mais le but avoué était de se limiter aux textes originaux.
Ca fait du kilomètre...
vendredi 16 juin 2017
La Planète sauvage
Juste La Planète sauvage.
Le film d'animation étrange et fou réalisé par René Laloux (Gandahar, Les Maîtres du temps) en 1973 vient de ressortir, en VOD et DVD, en HD, dans une version restaurée en 2016 par Arte.
lundi 15 mai 2017
Random work of wow : entre Terre et Mars
Je viens de tomber sur ces superbes posters de Matt Taylor, un des artistes de Black Dragon Press. Y a plein d'autres trucs cools dans leur catalogue, de Sherlock à Poe en passant par Tarkovsky. A 40£ pièce, c'est p'tet' un poil cher, mais ça ferait joli dans le hall, c'est certain.
lundi 1 mai 2017
Cab Calloway's Old Man in the Mountain
The Old Man of The Mountain est l'un des trois cartoons de Betty Boop dans lesquels Cab Calloway apparaît, et probablement mon favori. C'est non-stop Cab du début jusqu'à la fin. Il y incarne tout simplement la totalité des personnages, excepté Betty bien entendu, du lion-sur-lapins d'introduction au Vieil Homme lui-même en passant par cet étrange hibou.
Ce qui me fascine surtout ici, néanmoins, c'est l'usage de rotoscopie lorsque le Vieil Homme se met à danser avec Betty, interprétant tour à tour deux de ses chansons, You Gotta Hi-De-Hi puis The Scat Song. Quoique logique (Max Fleischer est l'inventeur du rotoscope, après tout), cet effet n'en reste pas moins intrigant à deux titres. D'abord, il tranche fortement avec l'animation, plutôt brute, du reste du métrage, les techniques des frères Fleischer en 1933 étant loin d'avoir atteint le niveau de maîtrise qu'ils afficheront sur Superman sept ans plus tard, abusant de boucles et de raccourcis, mais surtout, il permet d'ancrer ce cartoon dans une étrange réalité. Le mec danse, quoi.
C'est que, dans les deux autres cartoons de la collaboration Fleischer-Calloway (Minnie the Moocher et Snow White), les personnages de Cab sont des ombres menaçantes un brin impersonnelles, des squelettes, crânes et fantômes chantant, jouant et buvant. Ici, évoquant la même imagerie, il est tout de même bien plus explicite.
Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que les chansons de Cab parlent d'alcool et de drogue (par exemple, "kicking the gong around" était un argot connu pour "fumer de l'opium"), et il a longtemps été soutenu (notamment par la Paramount) que les Fleischer ignoraient tout des références de Calloway, mais à chaque fois que je regarde ces films, et surtout celui-là, je ne peux m'empêcher de penser que l'imagerie suggère justement tout l'inverse.
C'est ce qui a d'ailleurs valu aux films d'être interdits par la censure américaine d'après-guerre, avant qu'ils ne tombent dans le domaine public.
Ce qui me fascine surtout ici, néanmoins, c'est l'usage de rotoscopie lorsque le Vieil Homme se met à danser avec Betty, interprétant tour à tour deux de ses chansons, You Gotta Hi-De-Hi puis The Scat Song. Quoique logique (Max Fleischer est l'inventeur du rotoscope, après tout), cet effet n'en reste pas moins intrigant à deux titres. D'abord, il tranche fortement avec l'animation, plutôt brute, du reste du métrage, les techniques des frères Fleischer en 1933 étant loin d'avoir atteint le niveau de maîtrise qu'ils afficheront sur Superman sept ans plus tard, abusant de boucles et de raccourcis, mais surtout, il permet d'ancrer ce cartoon dans une étrange réalité. Le mec danse, quoi.
C'est que, dans les deux autres cartoons de la collaboration Fleischer-Calloway (Minnie the Moocher et Snow White), les personnages de Cab sont des ombres menaçantes un brin impersonnelles, des squelettes, crânes et fantômes chantant, jouant et buvant. Ici, évoquant la même imagerie, il est tout de même bien plus explicite.
Pourquoi est-ce intéressant ? Parce que les chansons de Cab parlent d'alcool et de drogue (par exemple, "kicking the gong around" était un argot connu pour "fumer de l'opium"), et il a longtemps été soutenu (notamment par la Paramount) que les Fleischer ignoraient tout des références de Calloway, mais à chaque fois que je regarde ces films, et surtout celui-là, je ne peux m'empêcher de penser que l'imagerie suggère justement tout l'inverse.
C'est ce qui a d'ailleurs valu aux films d'être interdits par la censure américaine d'après-guerre, avant qu'ils ne tombent dans le domaine public.
lundi 3 avril 2017
This is why I never get anything done
Je suis toujours un peu beaucoup très fort ennuyé quand je me retrouve à laisser des mois complets défiler sans avoir publié le moindre billet.
Bon, j'ai jamais été un frénétique non plus, et en dehors du mois séquentiel de mai dernier qui fait honteusement gonfler les scores (et m'a mis dans le mood to write au point de vouloir tenter un rythme hebdomadaire avant de me calmer et de m'ajuster sur du mensuel - que j'n'arrive même pas à tenir), j'ai rarement une douzaine d'articles par an depuis 2013 que je tiens ce blog. Je suis même plutôt du genre à disparaître par tranches de six mois sans laisser d'adresse et/ou à programmer des tas d'articles à l'avance. Tout ça est du au seul et néanmoins bien réel problème de ma rédaction multisupport : je suis un as de la dispersion désordonnée.
Je commence à écrire un truc, puis change, débute quinze articles en même temps, pitche quatre fictions à la file à des amis, commence moi-même à rédiger quelque chose, et ne finit rien, sur aucun des tableaux.
Pourtant, j'ai de quoi faire rien qu'avec la diversité des articles que je publie. Certains sont des traductions de textes trouvés au hasard du web auxquels j'ajoute mes propres considérations, d'autres sont de purs travaux de recherches, quelques uns s'écrivent en quarante-cinq secondes montre en main, la plupart prennent des semaines à se finir pour se lire en moins de dix minutes. C'est le but, mais la dose de travail à la rédaction d'un article (en dehors des pauses random) est totalement incompatible avec la volatilité avec laquelle je les écris.
Dernièrement, j'ai débuté un article expliquant pourquoi je collectionnais les éditions de Beowulf. J'ai au fil des années accumulé, dans toutes les langues (que je sais lire, s'entend), toutes les traductions que je pouvais trouver du poème épique millénaire (et j'en ai des vieilles), des épisodes raccourcis pour des besoins anthologiques, des tas de bande dessinées adaptées du mythe, un nombre incalculable de versions jeunesse illustrées par des types aussi ronflants que Michael Foreman ou John Howe, des inspirations plus discrètes comme Les Mangeurs de morts de Crichton, des récits dédiés aux personnages secondaires à l'image du Grendel de John Gardner, et, évidemment, toute transcription cinématographique ou télévisuelle de la chose... Ca m'a fait voir et lire un paquet d'horreurs, mais ça n'a jamais diminué la fascination que Beowulf a sur moi.
Sauf que donc, perdu dans les méandres de ma propre fantaisie (c'est vraiment l'usage et l'impact moderne du personnage qui m'intéresse, pas le poème d'origine, et ça fait forcément digresser très fort), l'article n'avance pas.
Alors, comme j'ai l'attention span d'un gosse de huit ans, je zappe.
Je zappe sur de la bédé que je connais par coeur, par exemple, tentant par exemple d'explorer les arcanes du voyage dans le temps à la mode Warren Ellis dans le dernier épisode de Planetary, ou en dressant un historique fou des magazines horrifiques en noir et blanc des années 70. J'ai même commencé à expliquer l'inavouable (et pourtant mondialement connu) secret derrière la narration particulière de la trilogie John Carter (et de l'oeuvre d'Edgar Rice Burroughs toute entière, en vérité). J'ai aussi l'impasse des "séries" d'articles sur ce blog même où, depuis des lustres, je dois rédiger les follow-ups des mes histoires de couvertures, aventures préhistoriques ou explorations de la fiction lesbienne. J'ai plein de pistes et d'idées pour les articles en question, j'en ai même planifié trois ou quatre suites dans les grandes largeurs, mais pour plein de raisons aléatoires, je n'ai pas encore débuté leurs rédactions.
C'est qu'au fil de mes recherches, je suis très vite distrait par mes propres découvertes, comme quand je me met à réfléchir à un récit mettant en scène un lansquenet allemand dans la Saxe du début XVIème, façon justicier solitaire complètement pop, après avoir revu Sanjuro et Yojimbo (ce qui date déjà de juillet-août dernier, si j'en crois mon propre post d'une photo du film), et que je finis par me plonger des les conflits religieux et la géographie de la Germanie de l'époque. Ou quand je me demande quel type d'épée je choisirais si, demain, je devenais immortel, à la Highlander (pour info, ce serait un sabre à deux mains de l'Allemagne renaissante, type kriegsmesser ou schweizersäbel - d'où l'histoire avec le lansquenet). Ce dernier point m'a fait fouiller le web à la recherche de spécimens particulièrement intrigants, jusqu'à palabrer avec un spécialiste des fauchons médiévaux quant à l'origine même des épées à simple tranchant sur le continent européen, considérant le trou entre les modèles romains et vikings d'avant le Xème siècle et l'arrivée du sabre à la fin du XIIIème (j'ai toujours pensé que les croisades contre les seldjoukide avaient importé le cimeterre en occident, mais, n'en déplaisent aux représentations iconiques de Saladin avec son épée-croissant, il semblerait que la présence même de l'arme dans la péninsule arabique à l'époque soit particulièrement discutée, les spécimens les plus récents en notre possession datant des années 1290, soit plus d'un siècle plus tard - alors que le modèle de l'arme date, lui, du VIIIème siècle turkmène). Notez par ailleurs que regarder un film est un effort marathonien pour moi, puisque j'ai sur un métrage exactement la même tendance qu'avec un livre : faire pause toutes les cinq minutes pour allumer Google et aller chercher pendant trois heures des tas de trucs auxquels une scène, un dialogue, une image ou que-sais-je encore m'a fait penser (je vous laisse imaginer le temps que prend pour moi le visionnage d'un truc comme la trilogie du Hobbit par exemple)... 'Voyez, même en expliquant pourquoi je digresse, je digresse.
Et ça, c'est pour les articles en cours, parce qu'il arrive également qu'un papier écrit à une vitesse éclair dans la frénésie de l'instant semble totalement absurde et sans intérêt une fois le point final tapoté. C'est ainsi ce qui est arrivé à une courte (et franchement polémique) chronique sur les rapports entre Disney, Tezuka et la création du manga, que j'ai après sa rédaction soumis à un ami vivant sur l'archipel et à même de corriger la (plus que) plausible erreur de mon jugement. Il fut plutôt enchanté par le texte, m'offrit quelques pistes supplémentaires et modifications bienvenues, mais au final, l'article ne me plait plus. Pas parce qu'il a été changé, bien au contraire, c'est même précisément le problème : je ne suis moi-même plus franchement d'accord avec le point que je développe, et je suis bien malgré moi totalement incapable de retoucher l'article pour lui redonner un semblant de pertinence.
J'ai l'air de me plaindre, mais il n'en est rien. Prenez plutôt ce billet pour une note d'intention, et l'assurance -parce qu'on m'a posé la question- que Fiction électrique n'est pas mort. Au ralenti assurément, en friche, peut-être, mais ce n'est que pour mieux ressemer.
Un de mes faux-dictons favoris dit que l'important n'est pas d'aléatoire, mais d'en revenir. J'écris, plein même, mais je ne conclus rien. Parfois, j'ai quatorze articles en cours, d'autres fois, j'en ai zéro. En ce moment, j'en ai trente. Ouaip, trente. Et c'est là où ça devient drôle : vu tout ce que j'ai en plan, j'aurais surement une douzaine de nouveaux articles en réserve d'ici quelques temps et je pourrais planifier deux-trois mois de posts intéressants à intercaler entre des random works of spur of the moment, et donner l'air d'être hyperactif tout en me tournant les pouces. Et ça me fait rire à un niveau lunaire. Les aléas du bloguisme.
'Pis au pire, je reposte toujours cinquante-mille liens et articles sur cinquante-mille sujets dont je n'parle pas systématiquement ici sur la page Facebook du blog. Vous pouvez même m'envoyer des messages pour me dire que je suis une grosse feignasse.
Bon, j'ai jamais été un frénétique non plus, et en dehors du mois séquentiel de mai dernier qui fait honteusement gonfler les scores (et m'a mis dans le mood to write au point de vouloir tenter un rythme hebdomadaire avant de me calmer et de m'ajuster sur du mensuel - que j'n'arrive même pas à tenir), j'ai rarement une douzaine d'articles par an depuis 2013 que je tiens ce blog. Je suis même plutôt du genre à disparaître par tranches de six mois sans laisser d'adresse et/ou à programmer des tas d'articles à l'avance. Tout ça est du au seul et néanmoins bien réel problème de ma rédaction multisupport : je suis un as de la dispersion désordonnée.
Je commence à écrire un truc, puis change, débute quinze articles en même temps, pitche quatre fictions à la file à des amis, commence moi-même à rédiger quelque chose, et ne finit rien, sur aucun des tableaux.
Pourtant, j'ai de quoi faire rien qu'avec la diversité des articles que je publie. Certains sont des traductions de textes trouvés au hasard du web auxquels j'ajoute mes propres considérations, d'autres sont de purs travaux de recherches, quelques uns s'écrivent en quarante-cinq secondes montre en main, la plupart prennent des semaines à se finir pour se lire en moins de dix minutes. C'est le but, mais la dose de travail à la rédaction d'un article (en dehors des pauses random) est totalement incompatible avec la volatilité avec laquelle je les écris.
Dernièrement, j'ai débuté un article expliquant pourquoi je collectionnais les éditions de Beowulf. J'ai au fil des années accumulé, dans toutes les langues (que je sais lire, s'entend), toutes les traductions que je pouvais trouver du poème épique millénaire (et j'en ai des vieilles), des épisodes raccourcis pour des besoins anthologiques, des tas de bande dessinées adaptées du mythe, un nombre incalculable de versions jeunesse illustrées par des types aussi ronflants que Michael Foreman ou John Howe, des inspirations plus discrètes comme Les Mangeurs de morts de Crichton, des récits dédiés aux personnages secondaires à l'image du Grendel de John Gardner, et, évidemment, toute transcription cinématographique ou télévisuelle de la chose... Ca m'a fait voir et lire un paquet d'horreurs, mais ça n'a jamais diminué la fascination que Beowulf a sur moi.
Sauf que donc, perdu dans les méandres de ma propre fantaisie (c'est vraiment l'usage et l'impact moderne du personnage qui m'intéresse, pas le poème d'origine, et ça fait forcément digresser très fort), l'article n'avance pas.
Alors, comme j'ai l'attention span d'un gosse de huit ans, je zappe.
Je zappe sur de la bédé que je connais par coeur, par exemple, tentant par exemple d'explorer les arcanes du voyage dans le temps à la mode Warren Ellis dans le dernier épisode de Planetary, ou en dressant un historique fou des magazines horrifiques en noir et blanc des années 70. J'ai même commencé à expliquer l'inavouable (et pourtant mondialement connu) secret derrière la narration particulière de la trilogie John Carter (et de l'oeuvre d'Edgar Rice Burroughs toute entière, en vérité). J'ai aussi l'impasse des "séries" d'articles sur ce blog même où, depuis des lustres, je dois rédiger les follow-ups des mes histoires de couvertures, aventures préhistoriques ou explorations de la fiction lesbienne. J'ai plein de pistes et d'idées pour les articles en question, j'en ai même planifié trois ou quatre suites dans les grandes largeurs, mais pour plein de raisons aléatoires, je n'ai pas encore débuté leurs rédactions.
C'est qu'au fil de mes recherches, je suis très vite distrait par mes propres découvertes, comme quand je me met à réfléchir à un récit mettant en scène un lansquenet allemand dans la Saxe du début XVIème, façon justicier solitaire complètement pop, après avoir revu Sanjuro et Yojimbo (ce qui date déjà de juillet-août dernier, si j'en crois mon propre post d'une photo du film), et que je finis par me plonger des les conflits religieux et la géographie de la Germanie de l'époque. Ou quand je me demande quel type d'épée je choisirais si, demain, je devenais immortel, à la Highlander (pour info, ce serait un sabre à deux mains de l'Allemagne renaissante, type kriegsmesser ou schweizersäbel - d'où l'histoire avec le lansquenet). Ce dernier point m'a fait fouiller le web à la recherche de spécimens particulièrement intrigants, jusqu'à palabrer avec un spécialiste des fauchons médiévaux quant à l'origine même des épées à simple tranchant sur le continent européen, considérant le trou entre les modèles romains et vikings d'avant le Xème siècle et l'arrivée du sabre à la fin du XIIIème (j'ai toujours pensé que les croisades contre les seldjoukide avaient importé le cimeterre en occident, mais, n'en déplaisent aux représentations iconiques de Saladin avec son épée-croissant, il semblerait que la présence même de l'arme dans la péninsule arabique à l'époque soit particulièrement discutée, les spécimens les plus récents en notre possession datant des années 1290, soit plus d'un siècle plus tard - alors que le modèle de l'arme date, lui, du VIIIème siècle turkmène). Notez par ailleurs que regarder un film est un effort marathonien pour moi, puisque j'ai sur un métrage exactement la même tendance qu'avec un livre : faire pause toutes les cinq minutes pour allumer Google et aller chercher pendant trois heures des tas de trucs auxquels une scène, un dialogue, une image ou que-sais-je encore m'a fait penser (je vous laisse imaginer le temps que prend pour moi le visionnage d'un truc comme la trilogie du Hobbit par exemple)... 'Voyez, même en expliquant pourquoi je digresse, je digresse.
Et ça, c'est pour les articles en cours, parce qu'il arrive également qu'un papier écrit à une vitesse éclair dans la frénésie de l'instant semble totalement absurde et sans intérêt une fois le point final tapoté. C'est ainsi ce qui est arrivé à une courte (et franchement polémique) chronique sur les rapports entre Disney, Tezuka et la création du manga, que j'ai après sa rédaction soumis à un ami vivant sur l'archipel et à même de corriger la (plus que) plausible erreur de mon jugement. Il fut plutôt enchanté par le texte, m'offrit quelques pistes supplémentaires et modifications bienvenues, mais au final, l'article ne me plait plus. Pas parce qu'il a été changé, bien au contraire, c'est même précisément le problème : je ne suis moi-même plus franchement d'accord avec le point que je développe, et je suis bien malgré moi totalement incapable de retoucher l'article pour lui redonner un semblant de pertinence.
J'ai l'air de me plaindre, mais il n'en est rien. Prenez plutôt ce billet pour une note d'intention, et l'assurance -parce qu'on m'a posé la question- que Fiction électrique n'est pas mort. Au ralenti assurément, en friche, peut-être, mais ce n'est que pour mieux ressemer.
Un de mes faux-dictons favoris dit que l'important n'est pas d'aléatoire, mais d'en revenir. J'écris, plein même, mais je ne conclus rien. Parfois, j'ai quatorze articles en cours, d'autres fois, j'en ai zéro. En ce moment, j'en ai trente. Ouaip, trente. Et c'est là où ça devient drôle : vu tout ce que j'ai en plan, j'aurais surement une douzaine de nouveaux articles en réserve d'ici quelques temps et je pourrais planifier deux-trois mois de posts intéressants à intercaler entre des random works of spur of the moment, et donner l'air d'être hyperactif tout en me tournant les pouces. Et ça me fait rire à un niveau lunaire. Les aléas du bloguisme.
'Pis au pire, je reposte toujours cinquante-mille liens et articles sur cinquante-mille sujets dont je n'parle pas systématiquement ici sur la page Facebook du blog. Vous pouvez même m'envoyer des messages pour me dire que je suis une grosse feignasse.
lundi 9 janvier 2017
Numérique ?
Il y a quelques jours, je suis tombé sur un article plutôt intéressant sur le blog de l'éditeur Walrus, spécialisé dans le pulp numérique.
On y parle du format, des choses qu'il est possible de faire avec le numérique que le papier est incapable de proposer, d'une lecture proche du web-browsing, d'options interactives, de plein de trucs qui sonnent tristement Internet 2.0 à mes oreilles et qui, je pense, loupent totalement le point, mais qu'il est assurément intéressant de discuter (c'est d'ailleurs ce que fait La Bauge Littéraire dans un long article-réponse). Ce qui m'intrigue surtout dans le discours (et ce tant chez Walrus que La Bauge), c'est l'aveu clair que la publication française n'a rien compris au numérique.
Laissez-moi vous exposer mon point de vue médicalement assisté sur la question.
Cette année, j'ai décidé de ne plus acheter de livres. Physiques, s'entend.
Voyez-vous, je déteste la poussière et les petites choses qui s'y développent me détestent en retour. Il y a certains bouquins de ma bibliothèque que je suis absolument incapables d'ouvrir à cause de ça, mais j'ai toujours su, plus ou moins, faire avec. Plus ces derniers mois. J'ai acheté L'Histoire des super-héros de Jean-Michel Ferragatti sur papier parce qu'il n'existe pas en numérique (c'est d'ailleurs seul seul bouquin de mon top11 que je possède en physique), et j'ai pas pu aller au bout. Y a fallu que j'en fasse mon propre scan (enfin, j'ai demandé qu'on m'en fasse un, même ça j'y arrivais pas). L'odeur du papier, de la colle, le nez qui pique et les yeux qui brûlent... Je vous passe les détails, le fait est que le livre papier, pour moi, c'est fini.
Comme un symbole, les dernières reliures que j'aurai acheté auront été celles que j'ai le plus longtemps cherché. Mises sur mon chemin totalement par hasard, les (futures) intégrales de Clark Ashton Smith chez Mnémos sont un rêve de (grand) gosse qui se réalise, après que j'aie passé des années à essayer de dénicher les éditions NéO du monsieur et/ou à le lire dans sa langue, faute de pouvoir me satisfaire des quatre pauvres nouvelles que j'ai de lui dans mes diverses anthologies. Une des raisons même qui ont motivé cet achat était d'ailleurs la présence hypothétique d'éditions numériques dans le lot. Les objets ont l'air superbes, j'adorerai (oui, c'est du futur) les avoir dans ma bibliothèque, mais dès que j'ai vu qu'il y avait des versions de bits et de bytes, j'ai su que je lirai ça sur ma liseuse. Et pourtant, c'était pas sûr du tout qu'il y ai ces fichiers numériques, ils n'étaient qu'un bonus de fin de parcours... Et là est tout mon dilemme depuis quelques années.
Je suis un adopteur (j'ai le droit d'inventer des mots) des premiers jours de la lecture numérique, je fais ça avec les bandes dessinées depuis près d'une décennie et l'encre électronique et le format epub sont probablement mes deux créations (plus ou moins) récentes favorites (avec les textiles hydrophobes, mais ça n'a rien à voir). J'adore l'idée d'avoir ma bibliothèque complète (qui ne comporte d'ailleurs pas tant de bouquins que ça) dans ma poche, j'ai même plus de livres en binaire que de volumes imprimés, en vérité. Sauf que je dois la très très large majorité de ma collection numérique à la gratuité de nombreuses oeuvres du XIXème et du début du XXème siècle désormais libres de droits (au hasard, les Paul d'Ivoi, Gaston Leroux, Michel Zévaco, Rosny aîné, Arthur Bernède et consort que je cite à l'envi quand il s'agit de pulp francophone) et, surtout, à une flopée de dévoués scanneurs qui se sont mis en tête, par exemple, de reporter sur leurs liseuses la totalité du catalogue Fleuve Noir Anticipation, totalement introuvable hors des cercles pirates. Des vieux trucs, quoi, car la production contemporaine sur le format est pratiquement nulle, et il s'avère que 101% de mes derniers achats de livres physiques se sont fait de dépit ou presque, faute de trouver le livre numérique correspondant. Parfois, c'est logique, comme dans le cas de petites éditions et de formats particuliers (L'Histoire des super-héros, disais-je, quoiqu'en écrivant à monsieur Néofélis, il me disait ne pas être contre l'idée d'une transcription numérique, simplement ignorant), mais souvent, c'est juste bassement frustrant : pourquoi Les Pionniers de la fantasy de Lyon Sprague de Camp (2010 chez Bragelonne) ou Orphée aux étoiles (la biographie de Poul Anderson chez les Humanos) n'existent pas en numérique alors que ces deux éditeurs mettent justement en avant leurs offres dématérialisées ?
Et encore, ce sont là deux éditeurs qui ont ce type d'offre pour commencer, parce que la plupart du temps, le numérique n'est même pas une arrière-pensée. Une des bédés qui m'intriguaient le plus cette année, O Sensei d'Edouard Cour, m'est ainsi passée sous le nez. Pourtant, l'éditeur Akileos a un semblant d'offre numérique, mais comme souvent, la conversion et la distribution sont sous-traités (par Avé!Comics en l'occurrence, qui ne propose qu'une toute petite partie du catalogue, et zéro nouveauté), l'éditeur d'origine ne s'en occupe même pas. La plupart du temps, on ne veut tellement pas voir le numérique qu'il est purement et simplement absent des boutiques en ligne, sur lesquelles on s'attendrait pourtant à le voir mis en avant (au hasard, je vous met au défi de trouver le catalogue epub de Fleuve Noir sur le site de Fleuve Noir - y a pas, tout est chez 12-21, qui se charge de la conversion pour trois ou quatre autres "gros" de l'édition), et quand on en propose, c'est bourré de DRMs et de limitations (l'offre sur Izneo, wannabe concurrent franco-français de ComiXology, par exemple, est restreinte à un horrible lecteur en ligne). Tout ça, une partie de moi est persuadée que c'est du à une chose et une chose seulement, une chose qui fait paniquer le moindre fournisseur de contenu de l'hexagone comme une pucelle devant un drakkar : le piratage. Parce que c'est l'Internet, 'voyez, les Grandes Eaux du grand-banditisme moderne, et par peur que le petit epub de 600k vendu au triple de sa valeur soit immédiatement (et à juste titre?) disponible sur toutes les plate-formes illégales du monde, l'éditeur français préfère tout simplement ne pas le proposer, ou le blinder de saloperies qui le rendent certes "inviolable", mais également incompatible avec de nombreuses liseuses... Quand le fichier n'est pas carrément un chef-d'oeuvre d'incompétence en lui-même, comme l'horrible "réédition" de la Compagnie des Glaces par French Pulp.
Autre problème, outre l'indisponibilité, pourquoi, quand ils le sont, comme c'est le cas pour l'intégrale de La Patrouille du temps ou le dernier volume de L'Oeil de la nuit (pour citer deux parutions de 2016), sont-ils distribués AU MEME PRIX en physique et en numérique ? Ca me parait non seulement totalement injuste mais aussi et surtout totalement illogique. Et c'est d'autant plus agaçant quand on est bilingue et qu'on a la possibilité de comparer avec l'offre anglo-saxonne, largement uniformisée : Tarzan vs Kong ? $5.99 (environ 5,50€ au taux de janvier 2017). Les dragons de Marie Brennan ? $5.99 (contre 10€ au format Kindle pour la VF, que L'Atalante ne fournit même pas lui-même). Un abonnement illimité à ComiXology ? $5.99 (mon royaume pour cette offre hors US!). On trouve aussi un paquet d'offres promotionnelles et gratuites, comme le superbe "club de lecture" de Tor.com, blog éditorial parent de l'éditeur Tor/Forge et devenu sa branche numérique en 2015 (avec une sacrée sélection, c'est là que j'ai pour la première fois entendu parler du Problème à trois corps de Liu Cixin, par exemple).
Evidemment, il y a des exceptions, et le catalogue de petits éditeurs français comme (justement) Walrus est plein de prose à 2,99€ pièce, de même qu'on n'échappe pas, sur le territoire anglophone, à certains tarifs surévalués, comme chez HarperCollins où le prix moyen avoisine les $12.99, mais... C'est Walrus, un éditeur 100% numérique que personne ou presque ne connaissait avant qu'ils se fassent remarquer avec leur sonnette d'alarme imaginaire, et c'est HarperCollins, une boite centenaire avec toute la dimension "luxe" qui lui est rattachée outre-atlantique. Je râle sur les prix, parce que, globalement, la différence entre les offres nord-américaines et françaises varie du simple au double, mais, disais-je, le premier critère reste le catalogue proposé : le Ferragatti, j'en aurais acheté le numérique au prix du papier sans me poser de question, et quand je vois les Selected nonfictions de Neil Gaiman à treize dollars chez HarperCollins, ça me parait cher, mais pas excessif vu le contenu du bouquin... Entre ça et une poperie random démarrant une énième tri/penta/décalogie post-Tolkien comme le Guerre et dinosaures de Victor Milan à 18€ chez Fleuve Noir (ou plutôt, disais-je, chez 12-21) alors que sa VO vaut $6, y a quand même une sacrée marge.
Je lis sur mon ordinateur et/ou ma liseuse depuis des années et je n'ai jamais eu à m'en plaindre, certes, mais j'ai toujours pu me reporter sur le papier pour ce que je ne trouvais pas et/ou était trop cher en epub. Je n'ai pas choisi de passer au tout numérique, j'y ai été plus ou moins contraint au fil des années, et ce ne sont certainement pas les disponibilités ou les politiques tarifaires qui m'y ont poussé. Quoique j'aie fini par me décider à sauter le pas, je sais pertinemment que je me ferme ainsi une grande partie du paysage éditorial.
Parce que, pour répondre à la demi-question de monsieur Walrus, le problème de l'édition numérique, ce n'est pas le format, ça n'a jamais été le format, c'est beaucoup plus simple et premier degré que ça : c'est la qualité de ce qu'on propose aux lecteurs, à quel prix, et le fait qu'il est souvent tout bonnement impossible de trouver ce qu'on cherche.
Le problème, c'est l'éditeur, mais allez faire comprendre à une maison qui fait du papier depuis des décennies qu'elle n'a rien compris au numérique et qu'elle doit revoir sa politique... Non, c'est plus simple d'incriminer les hypothétiques pirates et d'invoquer les chiffres de vente ridicules d'un catalogue famélique pour justifier que "ça marche pas". Et tant que les éditeurs joueront à l'autruche sur leurs propres lacunes, l'offre numérique française restera ce qu'elle est.
Et ce qu'elle est est juste pleinement et simplement minable.
On y parle du format, des choses qu'il est possible de faire avec le numérique que le papier est incapable de proposer, d'une lecture proche du web-browsing, d'options interactives, de plein de trucs qui sonnent tristement Internet 2.0 à mes oreilles et qui, je pense, loupent totalement le point, mais qu'il est assurément intéressant de discuter (c'est d'ailleurs ce que fait La Bauge Littéraire dans un long article-réponse). Ce qui m'intrigue surtout dans le discours (et ce tant chez Walrus que La Bauge), c'est l'aveu clair que la publication française n'a rien compris au numérique.
Laissez-moi vous exposer mon point de vue médicalement assisté sur la question.
Cette année, j'ai décidé de ne plus acheter de livres. Physiques, s'entend.
Voyez-vous, je déteste la poussière et les petites choses qui s'y développent me détestent en retour. Il y a certains bouquins de ma bibliothèque que je suis absolument incapables d'ouvrir à cause de ça, mais j'ai toujours su, plus ou moins, faire avec. Plus ces derniers mois. J'ai acheté L'Histoire des super-héros de Jean-Michel Ferragatti sur papier parce qu'il n'existe pas en numérique (c'est d'ailleurs seul seul bouquin de mon top11 que je possède en physique), et j'ai pas pu aller au bout. Y a fallu que j'en fasse mon propre scan (enfin, j'ai demandé qu'on m'en fasse un, même ça j'y arrivais pas). L'odeur du papier, de la colle, le nez qui pique et les yeux qui brûlent... Je vous passe les détails, le fait est que le livre papier, pour moi, c'est fini.
Comme un symbole, les dernières reliures que j'aurai acheté auront été celles que j'ai le plus longtemps cherché. Mises sur mon chemin totalement par hasard, les (futures) intégrales de Clark Ashton Smith chez Mnémos sont un rêve de (grand) gosse qui se réalise, après que j'aie passé des années à essayer de dénicher les éditions NéO du monsieur et/ou à le lire dans sa langue, faute de pouvoir me satisfaire des quatre pauvres nouvelles que j'ai de lui dans mes diverses anthologies. Une des raisons même qui ont motivé cet achat était d'ailleurs la présence hypothétique d'éditions numériques dans le lot. Les objets ont l'air superbes, j'adorerai (oui, c'est du futur) les avoir dans ma bibliothèque, mais dès que j'ai vu qu'il y avait des versions de bits et de bytes, j'ai su que je lirai ça sur ma liseuse. Et pourtant, c'était pas sûr du tout qu'il y ai ces fichiers numériques, ils n'étaient qu'un bonus de fin de parcours... Et là est tout mon dilemme depuis quelques années.
Je suis un adopteur (j'ai le droit d'inventer des mots) des premiers jours de la lecture numérique, je fais ça avec les bandes dessinées depuis près d'une décennie et l'encre électronique et le format epub sont probablement mes deux créations (plus ou moins) récentes favorites (avec les textiles hydrophobes, mais ça n'a rien à voir). J'adore l'idée d'avoir ma bibliothèque complète (qui ne comporte d'ailleurs pas tant de bouquins que ça) dans ma poche, j'ai même plus de livres en binaire que de volumes imprimés, en vérité. Sauf que je dois la très très large majorité de ma collection numérique à la gratuité de nombreuses oeuvres du XIXème et du début du XXème siècle désormais libres de droits (au hasard, les Paul d'Ivoi, Gaston Leroux, Michel Zévaco, Rosny aîné, Arthur Bernède et consort que je cite à l'envi quand il s'agit de pulp francophone) et, surtout, à une flopée de dévoués scanneurs qui se sont mis en tête, par exemple, de reporter sur leurs liseuses la totalité du catalogue Fleuve Noir Anticipation, totalement introuvable hors des cercles pirates. Des vieux trucs, quoi, car la production contemporaine sur le format est pratiquement nulle, et il s'avère que 101% de mes derniers achats de livres physiques se sont fait de dépit ou presque, faute de trouver le livre numérique correspondant. Parfois, c'est logique, comme dans le cas de petites éditions et de formats particuliers (L'Histoire des super-héros, disais-je, quoiqu'en écrivant à monsieur Néofélis, il me disait ne pas être contre l'idée d'une transcription numérique, simplement ignorant), mais souvent, c'est juste bassement frustrant : pourquoi Les Pionniers de la fantasy de Lyon Sprague de Camp (2010 chez Bragelonne) ou Orphée aux étoiles (la biographie de Poul Anderson chez les Humanos) n'existent pas en numérique alors que ces deux éditeurs mettent justement en avant leurs offres dématérialisées ?
Et encore, ce sont là deux éditeurs qui ont ce type d'offre pour commencer, parce que la plupart du temps, le numérique n'est même pas une arrière-pensée. Une des bédés qui m'intriguaient le plus cette année, O Sensei d'Edouard Cour, m'est ainsi passée sous le nez. Pourtant, l'éditeur Akileos a un semblant d'offre numérique, mais comme souvent, la conversion et la distribution sont sous-traités (par Avé!Comics en l'occurrence, qui ne propose qu'une toute petite partie du catalogue, et zéro nouveauté), l'éditeur d'origine ne s'en occupe même pas. La plupart du temps, on ne veut tellement pas voir le numérique qu'il est purement et simplement absent des boutiques en ligne, sur lesquelles on s'attendrait pourtant à le voir mis en avant (au hasard, je vous met au défi de trouver le catalogue epub de Fleuve Noir sur le site de Fleuve Noir - y a pas, tout est chez 12-21, qui se charge de la conversion pour trois ou quatre autres "gros" de l'édition), et quand on en propose, c'est bourré de DRMs et de limitations (l'offre sur Izneo, wannabe concurrent franco-français de ComiXology, par exemple, est restreinte à un horrible lecteur en ligne). Tout ça, une partie de moi est persuadée que c'est du à une chose et une chose seulement, une chose qui fait paniquer le moindre fournisseur de contenu de l'hexagone comme une pucelle devant un drakkar : le piratage. Parce que c'est l'Internet, 'voyez, les Grandes Eaux du grand-banditisme moderne, et par peur que le petit epub de 600k vendu au triple de sa valeur soit immédiatement (et à juste titre?) disponible sur toutes les plate-formes illégales du monde, l'éditeur français préfère tout simplement ne pas le proposer, ou le blinder de saloperies qui le rendent certes "inviolable", mais également incompatible avec de nombreuses liseuses... Quand le fichier n'est pas carrément un chef-d'oeuvre d'incompétence en lui-même, comme l'horrible "réédition" de la Compagnie des Glaces par French Pulp.
Autre problème, outre l'indisponibilité, pourquoi, quand ils le sont, comme c'est le cas pour l'intégrale de La Patrouille du temps ou le dernier volume de L'Oeil de la nuit (pour citer deux parutions de 2016), sont-ils distribués AU MEME PRIX en physique et en numérique ? Ca me parait non seulement totalement injuste mais aussi et surtout totalement illogique. Et c'est d'autant plus agaçant quand on est bilingue et qu'on a la possibilité de comparer avec l'offre anglo-saxonne, largement uniformisée : Tarzan vs Kong ? $5.99 (environ 5,50€ au taux de janvier 2017). Les dragons de Marie Brennan ? $5.99 (contre 10€ au format Kindle pour la VF, que L'Atalante ne fournit même pas lui-même). Un abonnement illimité à ComiXology ? $5.99 (mon royaume pour cette offre hors US!). On trouve aussi un paquet d'offres promotionnelles et gratuites, comme le superbe "club de lecture" de Tor.com, blog éditorial parent de l'éditeur Tor/Forge et devenu sa branche numérique en 2015 (avec une sacrée sélection, c'est là que j'ai pour la première fois entendu parler du Problème à trois corps de Liu Cixin, par exemple).
Evidemment, il y a des exceptions, et le catalogue de petits éditeurs français comme (justement) Walrus est plein de prose à 2,99€ pièce, de même qu'on n'échappe pas, sur le territoire anglophone, à certains tarifs surévalués, comme chez HarperCollins où le prix moyen avoisine les $12.99, mais... C'est Walrus, un éditeur 100% numérique que personne ou presque ne connaissait avant qu'ils se fassent remarquer avec leur sonnette d'alarme imaginaire, et c'est HarperCollins, une boite centenaire avec toute la dimension "luxe" qui lui est rattachée outre-atlantique. Je râle sur les prix, parce que, globalement, la différence entre les offres nord-américaines et françaises varie du simple au double, mais, disais-je, le premier critère reste le catalogue proposé : le Ferragatti, j'en aurais acheté le numérique au prix du papier sans me poser de question, et quand je vois les Selected nonfictions de Neil Gaiman à treize dollars chez HarperCollins, ça me parait cher, mais pas excessif vu le contenu du bouquin... Entre ça et une poperie random démarrant une énième tri/penta/décalogie post-Tolkien comme le Guerre et dinosaures de Victor Milan à 18€ chez Fleuve Noir (ou plutôt, disais-je, chez 12-21) alors que sa VO vaut $6, y a quand même une sacrée marge.
Je lis sur mon ordinateur et/ou ma liseuse depuis des années et je n'ai jamais eu à m'en plaindre, certes, mais j'ai toujours pu me reporter sur le papier pour ce que je ne trouvais pas et/ou était trop cher en epub. Je n'ai pas choisi de passer au tout numérique, j'y ai été plus ou moins contraint au fil des années, et ce ne sont certainement pas les disponibilités ou les politiques tarifaires qui m'y ont poussé. Quoique j'aie fini par me décider à sauter le pas, je sais pertinemment que je me ferme ainsi une grande partie du paysage éditorial.
Parce que, pour répondre à la demi-question de monsieur Walrus, le problème de l'édition numérique, ce n'est pas le format, ça n'a jamais été le format, c'est beaucoup plus simple et premier degré que ça : c'est la qualité de ce qu'on propose aux lecteurs, à quel prix, et le fait qu'il est souvent tout bonnement impossible de trouver ce qu'on cherche.
Le problème, c'est l'éditeur, mais allez faire comprendre à une maison qui fait du papier depuis des décennies qu'elle n'a rien compris au numérique et qu'elle doit revoir sa politique... Non, c'est plus simple d'incriminer les hypothétiques pirates et d'invoquer les chiffres de vente ridicules d'un catalogue famélique pour justifier que "ça marche pas". Et tant que les éditeurs joueront à l'autruche sur leurs propres lacunes, l'offre numérique française restera ce qu'elle est.
Et ce qu'elle est est juste pleinement et simplement minable.
mardi 3 janvier 2017
Onze... films de 2016
Après la littérature, le cinéma.
Et 2016 fut un excellent cru. Je n'avais pas vécu une année aussi cinématographiquement exaltante depuis un bout de temps. 'Faut aussi dire que j'ai pas vraiment profité du cinéma depuis un bout de temps. Il y a encore quelques années de ça, j'habitais à 500m d'un cinéma de quartier au tarif plancher, et sans compter les affres du transport campagnard, je suis moyen chaud pour bouger à 30bornes et dépenser 19€ pour aller voir des trucs à la qualité somme toute relative (surtout en VF...). Ainsi donc, si mes goûts n'ont foncièrement pas changé (et sont les même qu'en littérature, en toute logique), j'en profite assurément nettement moins, me retranchant sur une VOD au facteur eye-candy autrement plus limité et aux dates de sorties assez aléatoires. Toutefois, disais-je, cette année fut exaltante, diablement fun, et rattrape un exercice 2015 pour lequel je ne faisais pas encore de top mais que j'avais trouvé absolument dégueulasse. J'ai pris un pied monumental à regarder des romances SF mielleuses au ras des pâquerettes, des aventures de l'ouest bêtes comme un canon de peacemaker, des rocambolesqueries junglesques ultra communicatives, et tout un tas de trucs dont je connaissais la bassesse avant même d'en voir la moindre image ; et si j'ai vu parmi tous ces films des tas de trucs bien plus malins qu'ils n'y semblaient, chacun d'eux m'a aussi et avant tout comblé au delà de mes plus pop espérances.
Et comme pour les livres, ils seront rangés sans ordre de préférence, par date de sortie. (Et par simplicité, je donne les titres en VO.)
Synchronicity (22 janvier)
Je suis tombé par hasard sur Synchronicity, film low-budget présenté en avant première au Fantasia International Film Festival en juillet dernier et sorti officiellement cet hiver en VOD. La présence de Michael Ironside m'avait tenté, la promesse d'une histoire d'amour temporelle intrigué, et vers la vingtième minute, j'étais juste scotché à mon écran. Film d'ambiance bleuté se passant dans des années 80 indisctinctes, Synchronicity aborde le voyage dans le temps de manière fort actuelle (et réaliste, quoique totalement inexacte) tout en surfant sur toute une vague de visuels ultra-codifiés de la SF de la période qu'il réimagine, des intérieurs à la Highlander 2 (la chambre d'Abby, c'est l'appart de Connor) aux néons blafards dans des rues enfumées. La musique, tout comme le rythme, emprunte (voire pompe) Blade Runner, et tout baigne dans une atmosphère étrangement commune tandis que le scénario s'amuse avec des cordes qui n'ont rien de quantiques. Et j'adore quand je devine la fin d'un film à sa cinquième minute mais qu'il arrive quand même à me surprendre par la façon dont il la révèle. Prévisible, mais esthétique, bien monté et envoûtant, Synchronicity enfonce largement les espérances de son statut sans-le-sous et, sous couvert de SF dure et de course à la technologie, propose effectivement une jolie histoire d'amour.
Jane Got a Gun (27 janvier)
Quand j'ai vu ce film début juin, au bout de la nuit et de l'ennui, je ne m'attendais à rien. Le trailer était chouette, mais en me renseignant un peu, j'avais vu que sa production avait été un long purgatoire, avec 45 changements de cast, le départ de sa réalisatrice la veille du début du tournage et la perte du directeur photo. D'un film de femmes par des femmes, porté depuis le début par son actrice principale, Jane Got a Gun est devenu un truc hybride qui a encore pris deux ans après son premier coup de clap pour voir le jour. Le résultat ? Un slow burn basique de défense de maison avec des personnages forts en gueules, un western sec et froid curieusement contemplatif à la mode de maintenant, ouvertement féministe, fait de tensions muettes et dont le coeur/retournement "rien de tout cela ne serait arrivé si on n'avait pas été cons sept ans avant" n'empêche pas d'avancer malgré la tristesse de la réalisation. Portman y campe une dame autrement moins bête et putassière que la Annie Caulder de Raquel Welch (ce qui me faisait le plus peur vu le pitch), et la simplicité du récit offre beaucoup de place à des héros durs et meurtris mais franchement attachants. Ca ne porte honnêtement pas loin, mais c'est impeccablement construit et raconté. Et puis l'épilogue me fait craquer, et dans l'ouest lugubre et poussiéreux du film, le contraste est juste superbe.
Gods of Egypt (24 fevrier)
Dans mon intro, je disais "conneries communicatives dont je connaissais la bassesse [avant d'entrer dans la salle]", mais Gods of Egypt est vraiment un poisson à part dans le grand océan des bêtises hollywoodiennes de l'année. Après son mondialement décrié premier trailer, ce film était tellement sur ma liste que c'en était royalement injuste pour toutes les perles de substance que nous a offert le 7eme Art, mais j'en avais tout aussi royalement rien à cirer. Je devais voir ça. Le pire, c'est que je m'attendais "juste" à un film bête et niais, je le voyais comme un Roland Emmerich des nineties, un blockbuster positif et fun prompt à me rappeler quand j'étais môme et que je regardais des "films d'aventure" sans autre prétention que le divertissement. Sauf que non. Oooooh non. Avec ce croisement aléatoire et pourtant tellement logique entre Stargate, Les Chevaliers du Zodiaque et God of War, Alex Proyas accouche d'un engin délirant que jamais je n'aurais cru voir en 2016 dans un blockbuster à 250millions de dollars. Certes, la critique y aura vu un film bancal, basique, bête comme ses pieds et dont la moitié des acteurs ont l'air de se foutre (eux aussi) royalement (Butler excessif en rageux binaire, Jaimie Lanister juste vide, Black Panther gaybotine comme un cochon et Geoffrey Rush fait des grimaces devant un fond vert à chacune de ses apparitions), mais c'est oublier l'insanité globale du machin et le sérieux confondant avec lequel il est mis en scène, qui parviennent à emporter allez savoir comment cette indicible adhésion de grande gamelle involontaire. Son scénar' de jeu vidéo et son visuel bariolé de toku nippon en font de ces divertissements croustillants du samedi soir entre potes. J'étais dedans et parfaitement au fait de la bêtise intrisèque à l'entreprise rien que sur le principe bête et méchant des dieux à mi chemin entre des Transformers et des Chevaliers d'or ('faut tellement une version alternative avec un générique de Bernard Minet), mais c'est bien le ton du film, complètement premier degré, qui lui vaut sa place ici - avec Gods of Egypt, j'ai vécu un vrai grand et incroyablement improbable moment de cinéma : j'ai vu, de mes propres yeux, la naissance d'un nanar. Si. Un nanar en puissance, pur, la définition même du terme, le truc pas fait exprès, tourné avec une foi inébranlable mais finalement désespérément foiré, fauché, baroque jusqu'à l'absurde et complètement n'importe-quoi qui prend totalement par surprise. Gods of Egypt rate, puissance mille, absolument tout ce qu'il entreprend, et la chute est tout bonnement hallucinante de drôlerie accidentelle. Ce pauvre Alex Proyas est définitivement convaincu d'avoir fait un beau et bon film en hommage puissant à sa belle Egypte, et moi, je sais que la seule gloire qu'il aura jamais, c'est une page sur Nanarland et une place de choix dans un étal de vidéoclub ; une gloire de bonbon mou trop sucré parfum foirade de l'impossible que son premier degré transporte aux frontières de l'exceptionnel, un dérapage totalement incontrôlé qui accouche d'un objet cinéphilique d'une autre galaxie, un carnaval insensé et kitsch qu'on regarde ébahi (et mort de rire) en se demandant "comment ?"
The Jungle Book (13 avril)
Les premiers singes de l'année, parfait apéritif avant Tarzan ? J'étais pas sûr. Je partais avec beaucoup de curiosité mais aussi d'appréhension, les bande annonces me laissant un a-priori hyper négatif sur son traitement graphique. Ca avait l'air réaliste jusqu'à la faute, très, trop sombre (genre "grim&gritty post-Nolan des années 2010 ultracontrastées" sombre), avec des animaux aux allures de véritables monstres fantastiques. Ca me rappelait le Legend de Ridley Scott (un de mes pires souvenirs de jeunesse), un film au prémice du dimanche matin que le ton et le graphisme rendaient tout simplement insupportable à mes yeux. J'ai aussi eu peur du "syndrome Maléfique" et du film qui ne va pas au bout de son idée... Et au final... Au final, c'est un très très bon remake d'un très très bon film (surtout que, à cinquante ans d'intervalle, y a prescription). Les deux univers, l'enfantin et le réaliste, se télescopent bel et bien (les premières minutes sont très étranges) mais le film trouve un équilibre quasi contre-nature entre les deux (au moment de la scène du rocher de la paix, en fait), parvenant à émerveiller autant qu'à effrayer sans jamais donner l'impression d'aller vers l'un ou l'autre au hasard, jusqu'à un final enflammé honnêtement surprenant où les rôles s'inversent pendant une fraction de seconde. Le Livre de la jungle nouvelle formule a beau présenter des animaux et une jungle true-to-life, l'histoire reste bigger-than, fantaisiste et fraîche dans sa caractérisation, dans une jungle pleine de couleurs, avec des personnages attachants, beaucoup d'humour, s'offrant même deux chansons qui n'ont strictement rien à foutre là (Bare Necessities passe encore, mais Walken qui récite I Wanna Be Like You, c'est deux pleines minutes de torture), et ses monstres ne peuvent rien devant la majesté et la féérie de la jungle (les éléphants, bordel...). Peut-être que je l'apprécie d'autant plus que j'avais très peur de le voir, qui sait, toujours est-il que j'en ai pris plein les yeux (j'aurais même voulu plus de Kaa, qui était le perso que je craignais le plus, pour d'évidentes johansonesques raisons) et que je l'ai revu deux ou trois fois depuis avec le même plaisir. Ce film est remarquablement beau, et ça n'a l'air de rien, mais le gamin qui joue Mowgli s'éclate comme un fou, ça se voit, et en tant que seul humain du casting, son plaisir est ultra communicatif. Le pire dans tout ça, c'est que ce film que j'attendais comme apéritif négligeable et qui m'a tant surpris s'est bel et bien être avéré le parfait pendant de Tarzan, mais à l'envers, parce que Tarzan, c'était très très très très très très (très très...) nul.
Criminal (4 mai)
Un jour, avec ma maman et ma p'tite soeur, on a décidé de passer un après-midi polar au ciné. Moi, je voulais voir Kevin Costner avec les souvenirs d'un espion casser des bras comme un Liam Neeson toxicomane, et j'ai laissé ma maman et ma p'tite soeur choisir l'autre. Permettez-moi d'appuyer sur le goût particulièrement exquis de ces dames, qui ont choisi Money Monster, un thriller économique sur fond de prise d'otage étonnement solide, sinon convenu, qui propose quelques vrais instants d'accrochage à son siège et présente Jodie Foster comme une réalisatrice à suivre. Après avoir vu les deux films, j'avais même mis Money Monster à cette même place, définitivement le meilleur film des deux. Sauf qu'au moment de finaliser ma liste, j'avais oublié Money Monster, alors que Criminal m'était fermement resté en tête. J'aime Costner environ mille fois plus que Roberts et Clooney, ce qui aide forcément, et le prémice en lui-même m'intéressait de toute façon beaucoup plus à la base, mais si je ne peux aujourd'hui décemment pas faire cette liste sans ce film, en sortant de la salle, j'étais beaucoup plus mitigé. J'avais un (plusieurs) gros soucis sur le rythme, l'originalité toute relative du scénario et le côté résolument cliché de nombreux éléments clés du récit qui le faisaient passer pour un bête film d'action rédempteur au bon fond assumé qui voit le pire des salopards sauvé par la justesse d'un autre parti trop tôt. C'est à la réflexion, à l'impact résiduel, que Criminal prend toute sa valeur. Il y a quelques images très fortes, des échanges vraiment superbes entre Costner et Gadot, et le dernier plan, qui m'avait vraiment mis mal à l'aise au cinéma et que je trouve toujours profondément creepy, a fini par emporter mon indéfectible adhésion à force d'y penser. Je me suis aussi rendu compte que son réalisateur était l'auteur de The Iceman, aux thématiques très proches, plein de ces scènes "beauté du mal" très dérangeantes, et lui aussi servi par un casting cinq étoiles, remettant à rebours pas mal d'éléments en place. Criminal est une course-poursuite spy-fy prévisible mais beaucoup moins terre-à-terre qu'il n'y parait, à la cinématographie efficace quoiqu'inégale, qui me laisse éminemment partagé sur ses qualités narratives mais qui fait définitivement partie de ces films qui restent en tête pour plein de bonnes raisons. Et je ne pouvais pas ne pas en parler.
Equals (26 mai en VOD, initialement présenté en septembre 2015 à la Mostra de Venise)
I'm a sucker for scifi romance, j'l'ai d'ja dit ; Ex Machina m'avait presque fait tomber pour un robot l'an dernier (c'est très rigolo de se souvenir de ça quand, quelques mois avant d'écrire ces lignes, on a lu Les Androides rêvent-ils de titres à rallonge en entier pour la première fois et qu'on s'est dit que, si c'était nous, on serait parti avec Rachel), et j'ai la malchance(?) de réellement apprécier Kristen Stewart, alors... J'ai tenté. Mélange entre un Gattaca moderne, des restants de THX et un monde 1984ien délateur au possible, tourné dans ce que je suis persuadé être des leftovers du The Island de Michael Bay, Equals a un monde qui n'a pas beaucoup de sens, et... C'est pas grave, en fait. La bande annonce m'avait filé des frissons hypernégatifs de souvenir Equilibriumiens avec son "no emotions" un peu beaucoup passionnément basique, mais le monde froid et sans vie d'Equals fonctionne grâce à une humanité génétiquement modifiée où l'empathie est, au sens premier, une maladie dégénérative (dont l'imagerie résonne curieusement TRES fort dedans mon intérieur de moi-même) et le film traite le sujet émotionnel comme central. On échappe donc sans peine aux plotholes où on se demande comment des gens font pour se marier et avoir des gosses dans une société où ils prennent tous des medocs antisentiments, et le résultat est une ambiance réellement glaçante. La mise en scène suit, c'est très arty, clipesque, avec un fond sonore entre classique aérien et post-rock cristallin et des flous artistiques colorés filmés caméra au poing, instables et super près des gens, avec un relent insécure désorientant et voyeuriste. Au milieu de ça, une romance un peu niaise mais puissante et bien amenée (et qui passe d'autant mieux que Hoult est un illustrateur, donc déjà susceptible d'être plus désinhibé que ses collègues et avec un moyen de s'exprimer). C'est pas grandiose, mais c'est beau, touchant de simplicité, et ça me fait des choses le long de la colonne vertébrale (le final...). C'est, de loin, le film qui m'est le plus revenu en tête cette année, celui que j'ai le plus revu, que j'ai pris le plus de plaisir à revoir, j'en ai écouté la bande son en boucle, et je pense très sincèrement que c'est mon film favori de 2016. Yea. I am a sucker for sci-fi romance.
Kubo and the Two Strings (13 aout)
Le studio Laika n'est pas tenu par des manches. A l'oeuvre sur Coraline, Paranorman et The Box Trolls, ayant été formé à la grande école d'Henry Jamesetlapèchegéante Selick, Kubo était pourtant leur premier film entièrement réalisé in-house, avec Travis Lnight, lead-animateur, en guise de réal. Le résultat ? Breath-fuckin-tacking. Et vous me pardonnerez la grossièreté. Kubo est beau, épique, fourmillant d'idées, avec un graphisme ciselé (quoique tourné sur fond vert et rehaussé de CGI, le stop motion reste indéniablement palpable et la patte Selick est bien plus présente que dans un Paranorman, par exemple), un casting vocal cinq étoiles et une bande-son absolument magique. Sous le déluge de superlatifs ? Un conte pour enfants sombre mais drôle et gai, habituel de la firme, n'épargnant ni douleur ni cruauté, narré quasiment à la première personne (l'intro est superbe), avec toujours cette touche de fantastique horrifique hyper-référencé, jouant cette fois-ci des monstres nippons pour ajouter à la surprise. Et puis c'est beau. Vraiment beau (du genre à faire regretter de pas l'avoir vu au ciné, même si le dévédé m'a permis de faire pause à tout bout de champ pour regarder les décors - sans rire). On n'atteint, scénaristes et réals étant loin d'en avoir le bagage, pas le niveau de maîtrise d'un Coraline (l'histoire est aussi beaucoup plus convenue, une simple quête initiatique avec ses persos et situations classiques), mais il y a ce "truc" incertain qui rend le voyage, tout prévisible qu'il soit, toujours merveilleux.
The Magnificent Seven (28 septembre)
L'idée me plaisait, le réal me plaisait, le cast me plaisait, les trailers me plaisaient... Le film m'a plu. Aussi simple que ça. Les Sept mercenaires nouvelle version n'a aucune utilité, et c'est précisément tout son intérêt. Le plot est connu (et pas que par l'original, lui-même un remake, et dont le prémice a été repris 115mille fois depuis) mais il y a justement un côté diablement engageant dans cet espèce de cocon scénaristique et caracteriel qui fait que le truc fonctionne. A mort. Ce film est convenu, prévisible et, pour être honnête, très artificiel, mais il a du style et pue la badasserie par tous les pores, espèce de spagh' ultra moderne avec une collection de gueules telle que j'en avais pas vu depuis Sergio Leone et des idées de mise en scène dont la démesure se dispute à l'archétypage (et une musique...). Souvent, il en prend des allures de bédé, bien aidé en ça par une colorimétrie jaunâsse de vieux pulp et des contrastes totalement exagérés. Les héros sont au diapason, Denzel transpire la classe, Pratt est fun, Ethan Hawke fait merveille en sniper hanté, les méchants sont ultra méchants et over-the-top, et si on oublie vite les autres persos, il leur reste quand même assez de temps d'écran (et de chara-design iconique) pour une scène d'anthologie ou deux (j'aime tout spécialement le fait qu'ils aient repris certains gimmicks des originaux mais aient construits des persos totalement différents avec - D'Onofrio et Storm Shadow, notamment). Bon, pour sûr, c'est pas Hell or High Water (sublime western moderne), vous n'allez pas voir Les Sept mercenaires en 2016 pour recevoir le même genre de baffe que pouvait mettre Les Sept mercenaires de 1960, vous y allez pour vous souvenir de la baffe en question. Ce film est un trip nostalgique et gamin, gratuit et désinvolte, le genre de prod' qui démarre autour d'un verre en disant "Hé, viens on fait ça, comme quand on était mômes", et qui le fait superbement bien. C'est pas con, pas prétentieux non plus, c'est juste pour le plaisir. Et en ça, je retrouve Antoine Fuqua : son King Arthur m'avait rappelé pourquoi j'aimais les peplums, ses Sept mercenaires me rappellent pourquoi j'aime les westerns. Et bordel j'aime les westerns.
The Accountant (14 octobre)
Que voila un film intrigant, et le dernier à avoir fait la liste, en vérité. Je pense ne plus avoir besoin d'exprimer mon soft spot pour la spy-fy et les techno-thrillers, j'suis un gamin des films d'action des nineties et j'ai grandi pour en apprécier les évolutions techniques et esthétiques modernes, mais ce goût m'a souvent joué des tours, surtout quand le genre et ses tropes partent tellement dans tous les sens qu'on a encore du mal à savoir si c'est bien de la spy-fy ou du techno-thriller. En l'occurrence, ici, on est plutôt dans le giron pleinement action/one-man-army/pan-pan-boum-boum du truc, puisque plane une (gigantesque) ombre curieusement old-school mais néanmoins très moderne dans la mystéro-Bournerie que cette histoire de tueur-banquier laissait imaginer : John Wick. Difficile en effet de ne pas voir le spectre du nouveau nom de Keanu dans chaque placement de caméra ultra-léché, dans la précision mathématique du personnage comme de ses plans d'action, et dans la violence au visage froid qu'il décharge sans prévenir... De là vient aussi ce qui est à mon goût le pire défaut du film (faire de l'autisme un superpouvoir), mais comme chez Wick, comme chez Bourne et comme chez tous ces héros qui ont à leur manière redynamisé nos films d'action, ça marche dans la logique interne du récit. Et le perso est vraiment bon ! Certes, il est absurde, le prémice même est absurde, mais une fois l'incrédulité suspendue, il marche : c'est pas vraiment un super-héros, c'est un soliste un peu égoïste, sa condition le rend distant et fuyant, il est cheval entre son éducation rude et son hypersensibilité, et il a juste une manière plus qu'évocatrice de la décharger. Il est présenté si sérieusement qu'on n'a pas vraiment l'idée de s'arrêter pour se dire "Hé mais c'est n'importe-quoi". On accepte, parce que c'est comme ça. Et c'est tout ce côté premier degré qui fait le sel de ce genre de pièce au cinéma : parfois ça foire et ça donne Gods of Egypt, parfois ça marche et ça donne The Accountant (ou Mr Wolff en VF, parce que "Le Comptable" ça sonne pas assez badass, je suppose). The Accountant est un suiveur, il n'a rien de révolutionnaire, n'ayant ni la pertinence surprise de son inspiration ni même l'intention de l'avoir ; non, il s'inscrit dans la pure exploitation, et toute la question, c'est de la faire bien. Et The Accountant le fait bien, soigneusement codifié et réalisé (par un monsieur qui n'est pas un manche, d'ailleurs, puisqu'on doit aussi à Gavin O'Connor des trucs comme Warrior ou (tiens tiens) Jane Got a Gun - à croire qu'il est un spécialiste des projets blacklist), exploitant tant les défauts attendus que les qualités expectés de ce genre de production (jusqu'au final revelations-heavy à en devenir ridicule), avec pour principal effet (à part de m'avoir rendu salement impatient de voir John Wick 2 -genre, encore plus que le simple fait de savoir que John Wick 2 va sortir putain-,ce qui, dans sa catégorie d'actionner premier degré badass et cool, est déjà un compliment) de conforter l'amateur du genre dans le fait qu'il aime ces films. Ouaip, encore un film "zone de confort", à croire que j'ai vu que ça cette année...
Jack Reacher: Never go Back (21 octobre)
On m'avait dit et j'avais lu tellement de mal de ce film que je l'ai vu, si en pas en traînant les pieds (Jack Reacher fut de mes favoris de 2012 et j'attendais quand même sa suite, malgré l'absence de Christopher McQuarrie aux manettes, avec beaucoup de curiosité), au moins avec un fort a-priori. Quelle charmante surprise, alors, quand le film s'avère, à défaut d'être spécialement marquant, au moins compétent et conscient de ce qu'il fait. On se laisse assez facilement embarquer par un trio de héros plutôt bien pensé et agréable à suivre, le méchant très méchant est autrement plus inquiétant que Jai Courtney, et si l'intrigue globale se boucle de manière un peu tire-bouchonnée, c'était de toute façon déjà le cas dans le premier film... Alors quoi ? Pourquoi tant de haine ? Eh bien tout simplement, Never go Back n'a, stylistiquement comme scénaristiquement, pas grand chose à voir avec le premier volet, et la comparaison n'est pas franchement flatteuse. Sans compter qu'il est bien basiquement un moins bon film pour commencer, il souffre surtout d'une rupture de rythme assez flagrante et pas toujours maîtrisée par Edward Zwick, qu'on sait plus à l'aise sur des films plus posés (voir Le Dernier samourai ou Blood Diamond). Ce qui est très drôle et très paradoxal, c'est que son CV en faisait réellement un remplaçant tout désigné à l'esthétisme lent que McQuarrie avait développé sur le premier, mais que, justement, Zwick ne maîtrise pas le rythme imposé par la course-poursuite continue de ce second volet, là où McQuarrie avait parfaitement réussi la transition blockbusteresque sur Mission Impossible 5. De là découle un film un peu bâtard, trop propre et trop calibré, trop "Bournien" pour être honnête (ce qui est très drôle à dire quand, justement, la cuvée Bourne annuelle fut l'un des pires films de l'été), et dont le montage ne fait que souligner les errances d'un scénario qui tente à la fois d'humaniser la figure monolithique de Reacher tout en appuyant sur son côté Terminator invincible, auquel il faut ajouter une intrigue espionne qui était déjà strictement prétexte et bête dans le livre... Et c'est précisément là qu'intervient un détail hors-le-film qu'on oublie vite mais qui m'a frappé : ce côté plan-plan mécanique, purement récréatif ou presque, et le passage d'une histoire à l'autre d'un policier quasi contemplatif à de la grosse baston post-militariste, c'est précisément ce qui fait tout le sel des bouquins de Lee Child, auteur au style pulp cinématographique à souhait qui n'a jamais caché écrire pour le fun et pour le fric. Never go Back est, c'est un fait et je l'ai déjà souligné, moins bon que le précédent, mais il est également une parfaite illustration de son matériau d'origine. Il y a quatre ans, Jack Reacher m'avait donné envie de lire ; cet automne, Never go Back m'a rappelé mes sensations de lecture.
Arrival (11 novembre)
Ben oui, Arrival, bien sûr, Arrival. Bon, qu'on soit clair dès le début, je savais quelle réputation avait le film en y allant, je connaissais l'histoire (la nouvelle d'origine est une de mes références absolues en hard SF), j'étais totalement acquis à sa cause et je voulais qu'il m'en mette plein les yeux. Mon biais n'est pas assez prononcé et je n'suis pas assez cinéphile pour vérifier ou commenter le péremptoire consensus qui voudrait que ce soit "le meilleur film de SF de la décennie" ou "le nouveau 2001", mais ce qui est certain, c'est que question m'en mettre plein les yeux, il ne s'est pas fait prier. On sent, surtout dans la mise en scène des tenants militaires de l'opération, ce qui avait fait le succès de Villeneuve sur Sicario, l'image scotche à son siège et le sound design est proprement terrifiant (jusqu'à friser très sérieusement mes extrêmes misophones et nictophobes), le slow burn courant de l'arrivée au camp de base à l'entrée dans le vaisseau extra-terrestre étant probablement, oui, la meilleure pièce de cinéma de l'année. Mais il y a un mais. Parce que la comparaison avec Sicario peut être étendue à tout le film, en fait. Sa structure, son rythme, son découpage, son montage, sa musique, ses personnages, tout. De fait, tant qu'il est question de raconter avec des images (les imbrications des flashbacks/forwards et la confusion temporelle de Louise, par exemple), Villeneuve fait un boulot magistral, mais sa narration hypervisuelle s'accorde (assez logiquement) mal avec une intrigue linguiste étonnement précise, un secret militaire laissé intentionnellement opaque et d'importantes considérations métaphysiques qu'il eut été bon de longuement expliquer, plombant souvent le rythme et diluant peu à peu l'effet boeuf de sa première demi heure. Le scénario semble trop dense, trop touffu pour qu'on en reste à ce brouhaha ambiant, certes parfaitement en phase avec l'état émotionnel d'une héroïne qu'on suit à la première personne, mais qui ne semble jamais réellement maîtrisé (et j'ai tendance à penser que son recours à la voix off est un aveu de faiblesse à ce niveau là). A l'extrême opposé de la première demi-heure de trouve ainsi la dernière, un rush en forme de puzzle -assurément volontairement- incompréhensible dont on récupère certes les pièces maîtresses mais qui laisse de frustrantissimes -et pas tous volontaires- trous, et une partie de moi ne peut s'empêcher de penser que j'ai souvent du à ma connaissance du texte d'origine de boucher ceux qui pleuvent au fil du récit. Reste que Villeneuve sait faire des images, construire des moments et donner de l'impact à ses scènes, et que s'il peine à raconter une histoire, il plante suffisamment de graines dans ses moments forts pour rattraper l'attention parfois glissante de son spectateur (j'avais d'ailleurs aussi eu cette sensation de "ventre mou" au milieu de Sicario, et c'est exactement ce que je craignais sur Arrival) et lui remplir les yeux dès qu'il en a l'occasion. En résulte un bel objet de cinéma, un film effectivement superbe dont les scènes majeures resteront en tête pendant un bout de temps, mais aux faiblesses tout aussi visibles que ses forces. Sa principale qualité, et rafraîchissante originalité, c'est d'être un blockbuster de SF intelligent, sans le moindre coup de poing, une espèce de songe étrange dont le rythme lancinant et la froideur (le réalisme?) ambiante s'accordent aussi paradoxalement que parfaitement à l'improbabilité scénaristique. Je ne sais pas, disais-je, s'il mérite sa dithyrambique réception et sa réputation de futur culte, j'en doute même très certainement, mais il mérite assurément celle qui en fait un bon et beau film, et il a par ailleurs le bon goût de confirmer Villeneuve comme un excellent réalisateur "de l'image" (et ça me pump grave pour Blade Runner 2049, semblant de rien, parce que ça aussi, c'est le genre de film dont je n'attend rien d'autre que du plein les yeux contemplatif - et putain, s'il arrive à avoir son Dune...)
Mentions spéciale
Spartacus (13 mars)
Oui, Spartacus. Y a eu Spartacus au ciné cette année. Mais un Spartacus tout à fait spécial. Voyez-vous, pendant qu'on s'amusait à faire un remake dégueulasse de Ben Hur, j'ai vu un truc très étrange au cinéma cette année. Enfin, étrange... étrange javaisjamaisvuavant, pas étrange bizarre : j'ai été voir un ballet.
Et c'est...... fascinant. Bon, j'ai choisi, hein, j'ai été voir Spartacus, comme ça au moins j'étais sûr d'y trouver un demi intérêt, mais le truc c'est que j'ai vu une des représentations du Bolchoï diffusées au cinéma... Et c'est juste complètement dingue. Ca m'a fait le même genre d'effet que de regarder l'original muet d'un film que je connaissais. Il m'a beaucoup fait penser à ma première vision de Metropolis restauré, par exemple, mais je vais prendre un exemple plus pop et plus parlant : Frankenstein. Le film de 1931 est un remake d'un film muet de 1910, et le screenplay est sensiblement le même, sauf que ça dit rien, c'est du muet, y a juste une bombarde musicale et des gens qui se meuvent à l'écran. Spartacus en ballet, c'est pareil. L'histoire que j'connais, racontée en mouvements amples et affectés. Et narrativement, c'est un truc de dingue. Y manque rien. Toutes les scènes sont super compréhensibles, les danseurs sont tellement expressifs qu'on ne rate absolument rien de qui fomente un mauvais coup ou qui a peur pour l'autre, et dans le même temps, ça virevolte partout, y a des légionnaires qui font des triples axels, des courtisanes qui font des splits par dessus des esclaves prostrés avec emphase, des bergers qui dansent avec des satyres... C'est... Fascinant, ouaip, j'ai pas d'autre mot. Ca compte pas vraiment, mais c'est pourtant la meilleure expérience que j'ai vécue dans un cinéma cette année.
Mentions
Deux docus bédé, d'abord Hergé : à l'ombre de Tintin, portrait comme son nom l'indique du créateur plutôt que de la créature, ce qui n'est pas arrivé souvent (surtout en comparaison du nombre d'études dédiée au petit reporter), puis Lucky Luke - La fabrique du western européen, dédié quant à lui tant aux auteurs qu'au personnage, et surtout à l'impact du cow boy de Morris sur l'imaginaire franco-belge. Zootopia, fun, joli, attachant, avec un putain de bon sujet et beaucoup de finesse, mais tristement incohérent narrativement - et j'aime pas incohérent dans mon polar, même quand les policiers sont des lapins mignons. Warcraft était carrément bon par rapport à la réputation dégueulasse qui le précédait, mais si le graphisme est réussi et le film clairement compétent (en même temps, fiston Bowie n'est pas un branquignol), c'est quand même très moyennement mon délire. Et j'ai regardé Deadpool, au pif, un aprem' d'ennui - c'est très con, pas très bon, narrativement au ras des pâquerettes, trop long (et pourtant ça dure 1h40), la fin pue du tchul et le cassage de quatrième mur à tout bout de champ c'est vraiment très chiant, mais j'ai rigolé comme un stupide d'un bout à l'autre et j'ai pu prouver à mes yeux et mes oreilles que Ryan Reynolds était bel et bien Deadpool en vrai (si, depuis le début, revoyez son Hannibal King dans Blade 3, c'est sidérant), so i guess, hurray ?
J'ai pas de liste d'attente particulière pour l'an prochain (Blade Runner 2049 et John Wick 2, c'tout), aussi finissons avec un mot sur The Legend of Tarzan, si vous le voulez bien.
Pour citer Winnie l'ourson : "oh, misère." Je voulais que ce film marche. Je voulais tellement que ce film marche. Je l'ai même défendu de certaines accusations que je trouvais étranges avant même de l'avoir vu. D'ailleurs, le voir, j'en avais la frousse, les premières images et l'affiche promotionnelle étaient assez dégueu à mon sens. Mais je voulais qu'il marche, j'étais même prêt à me forcer à l'aimer, tant je voulais qu'il venge John Carter. Et... non. Juste non. Merci, sans façon. Je me souviens qu'à l'issue du premier trailer (décembre 2015 quand même), j'avais écrit deux ou trois impressions, comme Margot Robbie qui ressemblait vraiment à cette Jane désespérément amoureuse, toujours en danger mais loin d'être sans ressource, qui vit dans mon imagination (je ne le répéterai jamais assez, Jane n'est pas une princesse en détresse, c'est une cible pour atteindre Tarzan, elle le sait très bien, et elle s'en fout - c'est même précisément la confiance absolue de Jane qui rend l'image même de Tarzan si puissante), comme le design des singes complètement abusé (genre "miniature du King Kong 2005" abusé), et comme je m'attendais à ce que monsieur Waltz cabotine encore plus que dans James Bond. Le tout baignant dans une imagerie exagérément badass qui donnait salement envie et absolument pas du tout à la fois. Du magnifiquement encourageant et de l'affreusement peu engageant en même temps, quoi. La seule chose que je n'avais pas jugée au préalable, c'était Lord Greystoke ; même après cet encart risible où Samuel L. Jackson l'invective dans un salon, je réservais mon avis. Il m'avait l'air apathique et j'avais peur du syndrome Mad Max Fury Road où il serait le fantôme de son propre film, mais je voulais juger sur pièce. Tout ce qui m'intéressait, c'était que ce soit une aventure autocontenue et de ne surtout pas avoir à vivre une énième origin story...
Au final, j'avais bon sur toute la ligne, en bien comme en mal. Par exemple, Margot Robbie. Margot Robbie est Jane Porter, et c'est le seul point positif du film. The Legend of Tarzan est un récit pulp débridé abracadabrantesque, ce qui n'est pas un mal en soi, mais dont les largesses narratives sont quasi impardonnables (le montage est ignoble, c'est le mec qui a fait les derniers Harry Potter, ça s'voit, et c'est pas un compliment) et dont le graphisme oscille difficilement entre l'absolument fantastique (la réunion avec les lions) et le CG ultra fake dégueulasse (absolument tout le reste). Jackson et Waltz sont deux clowns agaçants qui font des monologues inutiles, Djimon Hounsou, pauvre Djimon Hounsou, est le (sous-)méchant le plus inutile de l'univers, et Alex Skarsgård fait peine à voir en Tarzan constamment ballotté entre fiction et réalité, fatigué par sa propre légende et bien mal servi par l'incapacité du scénario à choisir l'un ou l'autre. C'est... pénible. Pénible en tant qu'amateur du personnage, évidemment, mais surtout en tant qu'amateur de cinéma. Y a des "moments", comme ces quelques secondes de retrouvailles avec les lions, ou ce plan dans la bataille finale où Tarzan rattrape Jane au vol et qu'elle se love dans ses bras quasi-instantanément, mais j'ai l'impression qu'il manque des bouts. Le film ne décolle jamais, et visuellement, c'est d'une tristesse... Les feuilles vertes désaturées et la pluie, ça marchait dans l'approche naturaliste d'Hugh Hudson, mais dans ce film tourné à 99% sur fond vert, c'est laid. Sans compter un rendu tout flou à demi éthéré qui ne rend pas service à la qualité plus que discutable des effets spéciaux et dont la lumière me fait penser à tellement de jeux vidéo aux shaders foireux que c'en serait drôle si ce n'était pas si triste.
Et si encore c'était fun ! Mais non. C'est chiant. Rendez-vous compte, ils ont réussi à rendre Tarzan chiant ! Au début du projet, j'imaginais au moins pouvoir en dire qu'il me faisait le même effet que John Carter, "emportant inconditionnellement mon adhésion malgré ses défauts", et c'était probablement le meilleur compliment que je pouvais lui faire, mais je refuse d'insulter John Carter avec ce film. Il l'a bel et bien vengé au box office, mais qualitativement... The Legend of Tarzan est un immense gâchis, un gâchis que je place au même rang que -tiens, tiens- le Mad Max de l'an dernier : des persos que j'adore, un bon cast, quelques chouettes images, mais un film narrativement effroyable, sans âme, creux en contenu, qui pue le fake de synthèse et se révèle au final juste désespérément, tristement et irrémédiablement... mauvais. Je suis amère déception.
Et 2016 fut un excellent cru. Je n'avais pas vécu une année aussi cinématographiquement exaltante depuis un bout de temps. 'Faut aussi dire que j'ai pas vraiment profité du cinéma depuis un bout de temps. Il y a encore quelques années de ça, j'habitais à 500m d'un cinéma de quartier au tarif plancher, et sans compter les affres du transport campagnard, je suis moyen chaud pour bouger à 30bornes et dépenser 19€ pour aller voir des trucs à la qualité somme toute relative (surtout en VF...). Ainsi donc, si mes goûts n'ont foncièrement pas changé (et sont les même qu'en littérature, en toute logique), j'en profite assurément nettement moins, me retranchant sur une VOD au facteur eye-candy autrement plus limité et aux dates de sorties assez aléatoires. Toutefois, disais-je, cette année fut exaltante, diablement fun, et rattrape un exercice 2015 pour lequel je ne faisais pas encore de top mais que j'avais trouvé absolument dégueulasse. J'ai pris un pied monumental à regarder des romances SF mielleuses au ras des pâquerettes, des aventures de l'ouest bêtes comme un canon de peacemaker, des rocambolesqueries junglesques ultra communicatives, et tout un tas de trucs dont je connaissais la bassesse avant même d'en voir la moindre image ; et si j'ai vu parmi tous ces films des tas de trucs bien plus malins qu'ils n'y semblaient, chacun d'eux m'a aussi et avant tout comblé au delà de mes plus pop espérances.
Et comme pour les livres, ils seront rangés sans ordre de préférence, par date de sortie. (Et par simplicité, je donne les titres en VO.)
Synchronicity (22 janvier)
Je suis tombé par hasard sur Synchronicity, film low-budget présenté en avant première au Fantasia International Film Festival en juillet dernier et sorti officiellement cet hiver en VOD. La présence de Michael Ironside m'avait tenté, la promesse d'une histoire d'amour temporelle intrigué, et vers la vingtième minute, j'étais juste scotché à mon écran. Film d'ambiance bleuté se passant dans des années 80 indisctinctes, Synchronicity aborde le voyage dans le temps de manière fort actuelle (et réaliste, quoique totalement inexacte) tout en surfant sur toute une vague de visuels ultra-codifiés de la SF de la période qu'il réimagine, des intérieurs à la Highlander 2 (la chambre d'Abby, c'est l'appart de Connor) aux néons blafards dans des rues enfumées. La musique, tout comme le rythme, emprunte (voire pompe) Blade Runner, et tout baigne dans une atmosphère étrangement commune tandis que le scénario s'amuse avec des cordes qui n'ont rien de quantiques. Et j'adore quand je devine la fin d'un film à sa cinquième minute mais qu'il arrive quand même à me surprendre par la façon dont il la révèle. Prévisible, mais esthétique, bien monté et envoûtant, Synchronicity enfonce largement les espérances de son statut sans-le-sous et, sous couvert de SF dure et de course à la technologie, propose effectivement une jolie histoire d'amour.
Jane Got a Gun (27 janvier)
Quand j'ai vu ce film début juin, au bout de la nuit et de l'ennui, je ne m'attendais à rien. Le trailer était chouette, mais en me renseignant un peu, j'avais vu que sa production avait été un long purgatoire, avec 45 changements de cast, le départ de sa réalisatrice la veille du début du tournage et la perte du directeur photo. D'un film de femmes par des femmes, porté depuis le début par son actrice principale, Jane Got a Gun est devenu un truc hybride qui a encore pris deux ans après son premier coup de clap pour voir le jour. Le résultat ? Un slow burn basique de défense de maison avec des personnages forts en gueules, un western sec et froid curieusement contemplatif à la mode de maintenant, ouvertement féministe, fait de tensions muettes et dont le coeur/retournement "rien de tout cela ne serait arrivé si on n'avait pas été cons sept ans avant" n'empêche pas d'avancer malgré la tristesse de la réalisation. Portman y campe une dame autrement moins bête et putassière que la Annie Caulder de Raquel Welch (ce qui me faisait le plus peur vu le pitch), et la simplicité du récit offre beaucoup de place à des héros durs et meurtris mais franchement attachants. Ca ne porte honnêtement pas loin, mais c'est impeccablement construit et raconté. Et puis l'épilogue me fait craquer, et dans l'ouest lugubre et poussiéreux du film, le contraste est juste superbe.
Gods of Egypt (24 fevrier)
Dans mon intro, je disais "conneries communicatives dont je connaissais la bassesse [avant d'entrer dans la salle]", mais Gods of Egypt est vraiment un poisson à part dans le grand océan des bêtises hollywoodiennes de l'année. Après son mondialement décrié premier trailer, ce film était tellement sur ma liste que c'en était royalement injuste pour toutes les perles de substance que nous a offert le 7eme Art, mais j'en avais tout aussi royalement rien à cirer. Je devais voir ça. Le pire, c'est que je m'attendais "juste" à un film bête et niais, je le voyais comme un Roland Emmerich des nineties, un blockbuster positif et fun prompt à me rappeler quand j'étais môme et que je regardais des "films d'aventure" sans autre prétention que le divertissement. Sauf que non. Oooooh non. Avec ce croisement aléatoire et pourtant tellement logique entre Stargate, Les Chevaliers du Zodiaque et God of War, Alex Proyas accouche d'un engin délirant que jamais je n'aurais cru voir en 2016 dans un blockbuster à 250millions de dollars. Certes, la critique y aura vu un film bancal, basique, bête comme ses pieds et dont la moitié des acteurs ont l'air de se foutre (eux aussi) royalement (Butler excessif en rageux binaire, Jaimie Lanister juste vide, Black Panther gaybotine comme un cochon et Geoffrey Rush fait des grimaces devant un fond vert à chacune de ses apparitions), mais c'est oublier l'insanité globale du machin et le sérieux confondant avec lequel il est mis en scène, qui parviennent à emporter allez savoir comment cette indicible adhésion de grande gamelle involontaire. Son scénar' de jeu vidéo et son visuel bariolé de toku nippon en font de ces divertissements croustillants du samedi soir entre potes. J'étais dedans et parfaitement au fait de la bêtise intrisèque à l'entreprise rien que sur le principe bête et méchant des dieux à mi chemin entre des Transformers et des Chevaliers d'or ('faut tellement une version alternative avec un générique de Bernard Minet), mais c'est bien le ton du film, complètement premier degré, qui lui vaut sa place ici - avec Gods of Egypt, j'ai vécu un vrai grand et incroyablement improbable moment de cinéma : j'ai vu, de mes propres yeux, la naissance d'un nanar. Si. Un nanar en puissance, pur, la définition même du terme, le truc pas fait exprès, tourné avec une foi inébranlable mais finalement désespérément foiré, fauché, baroque jusqu'à l'absurde et complètement n'importe-quoi qui prend totalement par surprise. Gods of Egypt rate, puissance mille, absolument tout ce qu'il entreprend, et la chute est tout bonnement hallucinante de drôlerie accidentelle. Ce pauvre Alex Proyas est définitivement convaincu d'avoir fait un beau et bon film en hommage puissant à sa belle Egypte, et moi, je sais que la seule gloire qu'il aura jamais, c'est une page sur Nanarland et une place de choix dans un étal de vidéoclub ; une gloire de bonbon mou trop sucré parfum foirade de l'impossible que son premier degré transporte aux frontières de l'exceptionnel, un dérapage totalement incontrôlé qui accouche d'un objet cinéphilique d'une autre galaxie, un carnaval insensé et kitsch qu'on regarde ébahi (et mort de rire) en se demandant "comment ?"
The Jungle Book (13 avril)
Les premiers singes de l'année, parfait apéritif avant Tarzan ? J'étais pas sûr. Je partais avec beaucoup de curiosité mais aussi d'appréhension, les bande annonces me laissant un a-priori hyper négatif sur son traitement graphique. Ca avait l'air réaliste jusqu'à la faute, très, trop sombre (genre "grim&gritty post-Nolan des années 2010 ultracontrastées" sombre), avec des animaux aux allures de véritables monstres fantastiques. Ca me rappelait le Legend de Ridley Scott (un de mes pires souvenirs de jeunesse), un film au prémice du dimanche matin que le ton et le graphisme rendaient tout simplement insupportable à mes yeux. J'ai aussi eu peur du "syndrome Maléfique" et du film qui ne va pas au bout de son idée... Et au final... Au final, c'est un très très bon remake d'un très très bon film (surtout que, à cinquante ans d'intervalle, y a prescription). Les deux univers, l'enfantin et le réaliste, se télescopent bel et bien (les premières minutes sont très étranges) mais le film trouve un équilibre quasi contre-nature entre les deux (au moment de la scène du rocher de la paix, en fait), parvenant à émerveiller autant qu'à effrayer sans jamais donner l'impression d'aller vers l'un ou l'autre au hasard, jusqu'à un final enflammé honnêtement surprenant où les rôles s'inversent pendant une fraction de seconde. Le Livre de la jungle nouvelle formule a beau présenter des animaux et une jungle true-to-life, l'histoire reste bigger-than, fantaisiste et fraîche dans sa caractérisation, dans une jungle pleine de couleurs, avec des personnages attachants, beaucoup d'humour, s'offrant même deux chansons qui n'ont strictement rien à foutre là (Bare Necessities passe encore, mais Walken qui récite I Wanna Be Like You, c'est deux pleines minutes de torture), et ses monstres ne peuvent rien devant la majesté et la féérie de la jungle (les éléphants, bordel...). Peut-être que je l'apprécie d'autant plus que j'avais très peur de le voir, qui sait, toujours est-il que j'en ai pris plein les yeux (j'aurais même voulu plus de Kaa, qui était le perso que je craignais le plus, pour d'évidentes johansonesques raisons) et que je l'ai revu deux ou trois fois depuis avec le même plaisir. Ce film est remarquablement beau, et ça n'a l'air de rien, mais le gamin qui joue Mowgli s'éclate comme un fou, ça se voit, et en tant que seul humain du casting, son plaisir est ultra communicatif. Le pire dans tout ça, c'est que ce film que j'attendais comme apéritif négligeable et qui m'a tant surpris s'est bel et bien être avéré le parfait pendant de Tarzan, mais à l'envers, parce que Tarzan, c'était très très très très très très (très très...) nul.
Criminal (4 mai)
Un jour, avec ma maman et ma p'tite soeur, on a décidé de passer un après-midi polar au ciné. Moi, je voulais voir Kevin Costner avec les souvenirs d'un espion casser des bras comme un Liam Neeson toxicomane, et j'ai laissé ma maman et ma p'tite soeur choisir l'autre. Permettez-moi d'appuyer sur le goût particulièrement exquis de ces dames, qui ont choisi Money Monster, un thriller économique sur fond de prise d'otage étonnement solide, sinon convenu, qui propose quelques vrais instants d'accrochage à son siège et présente Jodie Foster comme une réalisatrice à suivre. Après avoir vu les deux films, j'avais même mis Money Monster à cette même place, définitivement le meilleur film des deux. Sauf qu'au moment de finaliser ma liste, j'avais oublié Money Monster, alors que Criminal m'était fermement resté en tête. J'aime Costner environ mille fois plus que Roberts et Clooney, ce qui aide forcément, et le prémice en lui-même m'intéressait de toute façon beaucoup plus à la base, mais si je ne peux aujourd'hui décemment pas faire cette liste sans ce film, en sortant de la salle, j'étais beaucoup plus mitigé. J'avais un (plusieurs) gros soucis sur le rythme, l'originalité toute relative du scénario et le côté résolument cliché de nombreux éléments clés du récit qui le faisaient passer pour un bête film d'action rédempteur au bon fond assumé qui voit le pire des salopards sauvé par la justesse d'un autre parti trop tôt. C'est à la réflexion, à l'impact résiduel, que Criminal prend toute sa valeur. Il y a quelques images très fortes, des échanges vraiment superbes entre Costner et Gadot, et le dernier plan, qui m'avait vraiment mis mal à l'aise au cinéma et que je trouve toujours profondément creepy, a fini par emporter mon indéfectible adhésion à force d'y penser. Je me suis aussi rendu compte que son réalisateur était l'auteur de The Iceman, aux thématiques très proches, plein de ces scènes "beauté du mal" très dérangeantes, et lui aussi servi par un casting cinq étoiles, remettant à rebours pas mal d'éléments en place. Criminal est une course-poursuite spy-fy prévisible mais beaucoup moins terre-à-terre qu'il n'y parait, à la cinématographie efficace quoiqu'inégale, qui me laisse éminemment partagé sur ses qualités narratives mais qui fait définitivement partie de ces films qui restent en tête pour plein de bonnes raisons. Et je ne pouvais pas ne pas en parler.
Equals (26 mai en VOD, initialement présenté en septembre 2015 à la Mostra de Venise)
I'm a sucker for scifi romance, j'l'ai d'ja dit ; Ex Machina m'avait presque fait tomber pour un robot l'an dernier (c'est très rigolo de se souvenir de ça quand, quelques mois avant d'écrire ces lignes, on a lu Les Androides rêvent-ils de titres à rallonge en entier pour la première fois et qu'on s'est dit que, si c'était nous, on serait parti avec Rachel), et j'ai la malchance(?) de réellement apprécier Kristen Stewart, alors... J'ai tenté. Mélange entre un Gattaca moderne, des restants de THX et un monde 1984ien délateur au possible, tourné dans ce que je suis persuadé être des leftovers du The Island de Michael Bay, Equals a un monde qui n'a pas beaucoup de sens, et... C'est pas grave, en fait. La bande annonce m'avait filé des frissons hypernégatifs de souvenir Equilibriumiens avec son "no emotions" un peu beaucoup passionnément basique, mais le monde froid et sans vie d'Equals fonctionne grâce à une humanité génétiquement modifiée où l'empathie est, au sens premier, une maladie dégénérative (dont l'imagerie résonne curieusement TRES fort dedans mon intérieur de moi-même) et le film traite le sujet émotionnel comme central. On échappe donc sans peine aux plotholes où on se demande comment des gens font pour se marier et avoir des gosses dans une société où ils prennent tous des medocs antisentiments, et le résultat est une ambiance réellement glaçante. La mise en scène suit, c'est très arty, clipesque, avec un fond sonore entre classique aérien et post-rock cristallin et des flous artistiques colorés filmés caméra au poing, instables et super près des gens, avec un relent insécure désorientant et voyeuriste. Au milieu de ça, une romance un peu niaise mais puissante et bien amenée (et qui passe d'autant mieux que Hoult est un illustrateur, donc déjà susceptible d'être plus désinhibé que ses collègues et avec un moyen de s'exprimer). C'est pas grandiose, mais c'est beau, touchant de simplicité, et ça me fait des choses le long de la colonne vertébrale (le final...). C'est, de loin, le film qui m'est le plus revenu en tête cette année, celui que j'ai le plus revu, que j'ai pris le plus de plaisir à revoir, j'en ai écouté la bande son en boucle, et je pense très sincèrement que c'est mon film favori de 2016. Yea. I am a sucker for sci-fi romance.
Kubo and the Two Strings (13 aout)
Le studio Laika n'est pas tenu par des manches. A l'oeuvre sur Coraline, Paranorman et The Box Trolls, ayant été formé à la grande école d'Henry Jamesetlapèchegéante Selick, Kubo était pourtant leur premier film entièrement réalisé in-house, avec Travis Lnight, lead-animateur, en guise de réal. Le résultat ? Breath-fuckin-tacking. Et vous me pardonnerez la grossièreté. Kubo est beau, épique, fourmillant d'idées, avec un graphisme ciselé (quoique tourné sur fond vert et rehaussé de CGI, le stop motion reste indéniablement palpable et la patte Selick est bien plus présente que dans un Paranorman, par exemple), un casting vocal cinq étoiles et une bande-son absolument magique. Sous le déluge de superlatifs ? Un conte pour enfants sombre mais drôle et gai, habituel de la firme, n'épargnant ni douleur ni cruauté, narré quasiment à la première personne (l'intro est superbe), avec toujours cette touche de fantastique horrifique hyper-référencé, jouant cette fois-ci des monstres nippons pour ajouter à la surprise. Et puis c'est beau. Vraiment beau (du genre à faire regretter de pas l'avoir vu au ciné, même si le dévédé m'a permis de faire pause à tout bout de champ pour regarder les décors - sans rire). On n'atteint, scénaristes et réals étant loin d'en avoir le bagage, pas le niveau de maîtrise d'un Coraline (l'histoire est aussi beaucoup plus convenue, une simple quête initiatique avec ses persos et situations classiques), mais il y a ce "truc" incertain qui rend le voyage, tout prévisible qu'il soit, toujours merveilleux.
The Magnificent Seven (28 septembre)
L'idée me plaisait, le réal me plaisait, le cast me plaisait, les trailers me plaisaient... Le film m'a plu. Aussi simple que ça. Les Sept mercenaires nouvelle version n'a aucune utilité, et c'est précisément tout son intérêt. Le plot est connu (et pas que par l'original, lui-même un remake, et dont le prémice a été repris 115mille fois depuis) mais il y a justement un côté diablement engageant dans cet espèce de cocon scénaristique et caracteriel qui fait que le truc fonctionne. A mort. Ce film est convenu, prévisible et, pour être honnête, très artificiel, mais il a du style et pue la badasserie par tous les pores, espèce de spagh' ultra moderne avec une collection de gueules telle que j'en avais pas vu depuis Sergio Leone et des idées de mise en scène dont la démesure se dispute à l'archétypage (et une musique...). Souvent, il en prend des allures de bédé, bien aidé en ça par une colorimétrie jaunâsse de vieux pulp et des contrastes totalement exagérés. Les héros sont au diapason, Denzel transpire la classe, Pratt est fun, Ethan Hawke fait merveille en sniper hanté, les méchants sont ultra méchants et over-the-top, et si on oublie vite les autres persos, il leur reste quand même assez de temps d'écran (et de chara-design iconique) pour une scène d'anthologie ou deux (j'aime tout spécialement le fait qu'ils aient repris certains gimmicks des originaux mais aient construits des persos totalement différents avec - D'Onofrio et Storm Shadow, notamment). Bon, pour sûr, c'est pas Hell or High Water (sublime western moderne), vous n'allez pas voir Les Sept mercenaires en 2016 pour recevoir le même genre de baffe que pouvait mettre Les Sept mercenaires de 1960, vous y allez pour vous souvenir de la baffe en question. Ce film est un trip nostalgique et gamin, gratuit et désinvolte, le genre de prod' qui démarre autour d'un verre en disant "Hé, viens on fait ça, comme quand on était mômes", et qui le fait superbement bien. C'est pas con, pas prétentieux non plus, c'est juste pour le plaisir. Et en ça, je retrouve Antoine Fuqua : son King Arthur m'avait rappelé pourquoi j'aimais les peplums, ses Sept mercenaires me rappellent pourquoi j'aime les westerns. Et bordel j'aime les westerns.
The Accountant (14 octobre)
Que voila un film intrigant, et le dernier à avoir fait la liste, en vérité. Je pense ne plus avoir besoin d'exprimer mon soft spot pour la spy-fy et les techno-thrillers, j'suis un gamin des films d'action des nineties et j'ai grandi pour en apprécier les évolutions techniques et esthétiques modernes, mais ce goût m'a souvent joué des tours, surtout quand le genre et ses tropes partent tellement dans tous les sens qu'on a encore du mal à savoir si c'est bien de la spy-fy ou du techno-thriller. En l'occurrence, ici, on est plutôt dans le giron pleinement action/one-man-army/pan-pan-boum-boum du truc, puisque plane une (gigantesque) ombre curieusement old-school mais néanmoins très moderne dans la mystéro-Bournerie que cette histoire de tueur-banquier laissait imaginer : John Wick. Difficile en effet de ne pas voir le spectre du nouveau nom de Keanu dans chaque placement de caméra ultra-léché, dans la précision mathématique du personnage comme de ses plans d'action, et dans la violence au visage froid qu'il décharge sans prévenir... De là vient aussi ce qui est à mon goût le pire défaut du film (faire de l'autisme un superpouvoir), mais comme chez Wick, comme chez Bourne et comme chez tous ces héros qui ont à leur manière redynamisé nos films d'action, ça marche dans la logique interne du récit. Et le perso est vraiment bon ! Certes, il est absurde, le prémice même est absurde, mais une fois l'incrédulité suspendue, il marche : c'est pas vraiment un super-héros, c'est un soliste un peu égoïste, sa condition le rend distant et fuyant, il est cheval entre son éducation rude et son hypersensibilité, et il a juste une manière plus qu'évocatrice de la décharger. Il est présenté si sérieusement qu'on n'a pas vraiment l'idée de s'arrêter pour se dire "Hé mais c'est n'importe-quoi". On accepte, parce que c'est comme ça. Et c'est tout ce côté premier degré qui fait le sel de ce genre de pièce au cinéma : parfois ça foire et ça donne Gods of Egypt, parfois ça marche et ça donne The Accountant (ou Mr Wolff en VF, parce que "Le Comptable" ça sonne pas assez badass, je suppose). The Accountant est un suiveur, il n'a rien de révolutionnaire, n'ayant ni la pertinence surprise de son inspiration ni même l'intention de l'avoir ; non, il s'inscrit dans la pure exploitation, et toute la question, c'est de la faire bien. Et The Accountant le fait bien, soigneusement codifié et réalisé (par un monsieur qui n'est pas un manche, d'ailleurs, puisqu'on doit aussi à Gavin O'Connor des trucs comme Warrior ou (tiens tiens) Jane Got a Gun - à croire qu'il est un spécialiste des projets blacklist), exploitant tant les défauts attendus que les qualités expectés de ce genre de production (jusqu'au final revelations-heavy à en devenir ridicule), avec pour principal effet (à part de m'avoir rendu salement impatient de voir John Wick 2 -genre, encore plus que le simple fait de savoir que John Wick 2 va sortir putain-,ce qui, dans sa catégorie d'actionner premier degré badass et cool, est déjà un compliment) de conforter l'amateur du genre dans le fait qu'il aime ces films. Ouaip, encore un film "zone de confort", à croire que j'ai vu que ça cette année...
Jack Reacher: Never go Back (21 octobre)
On m'avait dit et j'avais lu tellement de mal de ce film que je l'ai vu, si en pas en traînant les pieds (Jack Reacher fut de mes favoris de 2012 et j'attendais quand même sa suite, malgré l'absence de Christopher McQuarrie aux manettes, avec beaucoup de curiosité), au moins avec un fort a-priori. Quelle charmante surprise, alors, quand le film s'avère, à défaut d'être spécialement marquant, au moins compétent et conscient de ce qu'il fait. On se laisse assez facilement embarquer par un trio de héros plutôt bien pensé et agréable à suivre, le méchant très méchant est autrement plus inquiétant que Jai Courtney, et si l'intrigue globale se boucle de manière un peu tire-bouchonnée, c'était de toute façon déjà le cas dans le premier film... Alors quoi ? Pourquoi tant de haine ? Eh bien tout simplement, Never go Back n'a, stylistiquement comme scénaristiquement, pas grand chose à voir avec le premier volet, et la comparaison n'est pas franchement flatteuse. Sans compter qu'il est bien basiquement un moins bon film pour commencer, il souffre surtout d'une rupture de rythme assez flagrante et pas toujours maîtrisée par Edward Zwick, qu'on sait plus à l'aise sur des films plus posés (voir Le Dernier samourai ou Blood Diamond). Ce qui est très drôle et très paradoxal, c'est que son CV en faisait réellement un remplaçant tout désigné à l'esthétisme lent que McQuarrie avait développé sur le premier, mais que, justement, Zwick ne maîtrise pas le rythme imposé par la course-poursuite continue de ce second volet, là où McQuarrie avait parfaitement réussi la transition blockbusteresque sur Mission Impossible 5. De là découle un film un peu bâtard, trop propre et trop calibré, trop "Bournien" pour être honnête (ce qui est très drôle à dire quand, justement, la cuvée Bourne annuelle fut l'un des pires films de l'été), et dont le montage ne fait que souligner les errances d'un scénario qui tente à la fois d'humaniser la figure monolithique de Reacher tout en appuyant sur son côté Terminator invincible, auquel il faut ajouter une intrigue espionne qui était déjà strictement prétexte et bête dans le livre... Et c'est précisément là qu'intervient un détail hors-le-film qu'on oublie vite mais qui m'a frappé : ce côté plan-plan mécanique, purement récréatif ou presque, et le passage d'une histoire à l'autre d'un policier quasi contemplatif à de la grosse baston post-militariste, c'est précisément ce qui fait tout le sel des bouquins de Lee Child, auteur au style pulp cinématographique à souhait qui n'a jamais caché écrire pour le fun et pour le fric. Never go Back est, c'est un fait et je l'ai déjà souligné, moins bon que le précédent, mais il est également une parfaite illustration de son matériau d'origine. Il y a quatre ans, Jack Reacher m'avait donné envie de lire ; cet automne, Never go Back m'a rappelé mes sensations de lecture.
Arrival (11 novembre)
Ben oui, Arrival, bien sûr, Arrival. Bon, qu'on soit clair dès le début, je savais quelle réputation avait le film en y allant, je connaissais l'histoire (la nouvelle d'origine est une de mes références absolues en hard SF), j'étais totalement acquis à sa cause et je voulais qu'il m'en mette plein les yeux. Mon biais n'est pas assez prononcé et je n'suis pas assez cinéphile pour vérifier ou commenter le péremptoire consensus qui voudrait que ce soit "le meilleur film de SF de la décennie" ou "le nouveau 2001", mais ce qui est certain, c'est que question m'en mettre plein les yeux, il ne s'est pas fait prier. On sent, surtout dans la mise en scène des tenants militaires de l'opération, ce qui avait fait le succès de Villeneuve sur Sicario, l'image scotche à son siège et le sound design est proprement terrifiant (jusqu'à friser très sérieusement mes extrêmes misophones et nictophobes), le slow burn courant de l'arrivée au camp de base à l'entrée dans le vaisseau extra-terrestre étant probablement, oui, la meilleure pièce de cinéma de l'année. Mais il y a un mais. Parce que la comparaison avec Sicario peut être étendue à tout le film, en fait. Sa structure, son rythme, son découpage, son montage, sa musique, ses personnages, tout. De fait, tant qu'il est question de raconter avec des images (les imbrications des flashbacks/forwards et la confusion temporelle de Louise, par exemple), Villeneuve fait un boulot magistral, mais sa narration hypervisuelle s'accorde (assez logiquement) mal avec une intrigue linguiste étonnement précise, un secret militaire laissé intentionnellement opaque et d'importantes considérations métaphysiques qu'il eut été bon de longuement expliquer, plombant souvent le rythme et diluant peu à peu l'effet boeuf de sa première demi heure. Le scénario semble trop dense, trop touffu pour qu'on en reste à ce brouhaha ambiant, certes parfaitement en phase avec l'état émotionnel d'une héroïne qu'on suit à la première personne, mais qui ne semble jamais réellement maîtrisé (et j'ai tendance à penser que son recours à la voix off est un aveu de faiblesse à ce niveau là). A l'extrême opposé de la première demi-heure de trouve ainsi la dernière, un rush en forme de puzzle -assurément volontairement- incompréhensible dont on récupère certes les pièces maîtresses mais qui laisse de frustrantissimes -et pas tous volontaires- trous, et une partie de moi ne peut s'empêcher de penser que j'ai souvent du à ma connaissance du texte d'origine de boucher ceux qui pleuvent au fil du récit. Reste que Villeneuve sait faire des images, construire des moments et donner de l'impact à ses scènes, et que s'il peine à raconter une histoire, il plante suffisamment de graines dans ses moments forts pour rattraper l'attention parfois glissante de son spectateur (j'avais d'ailleurs aussi eu cette sensation de "ventre mou" au milieu de Sicario, et c'est exactement ce que je craignais sur Arrival) et lui remplir les yeux dès qu'il en a l'occasion. En résulte un bel objet de cinéma, un film effectivement superbe dont les scènes majeures resteront en tête pendant un bout de temps, mais aux faiblesses tout aussi visibles que ses forces. Sa principale qualité, et rafraîchissante originalité, c'est d'être un blockbuster de SF intelligent, sans le moindre coup de poing, une espèce de songe étrange dont le rythme lancinant et la froideur (le réalisme?) ambiante s'accordent aussi paradoxalement que parfaitement à l'improbabilité scénaristique. Je ne sais pas, disais-je, s'il mérite sa dithyrambique réception et sa réputation de futur culte, j'en doute même très certainement, mais il mérite assurément celle qui en fait un bon et beau film, et il a par ailleurs le bon goût de confirmer Villeneuve comme un excellent réalisateur "de l'image" (et ça me pump grave pour Blade Runner 2049, semblant de rien, parce que ça aussi, c'est le genre de film dont je n'attend rien d'autre que du plein les yeux contemplatif - et putain, s'il arrive à avoir son Dune...)
Mentions spéciale
Spartacus (13 mars)
Oui, Spartacus. Y a eu Spartacus au ciné cette année. Mais un Spartacus tout à fait spécial. Voyez-vous, pendant qu'on s'amusait à faire un remake dégueulasse de Ben Hur, j'ai vu un truc très étrange au cinéma cette année. Enfin, étrange... étrange javaisjamaisvuavant, pas étrange bizarre : j'ai été voir un ballet.
Et c'est...... fascinant. Bon, j'ai choisi, hein, j'ai été voir Spartacus, comme ça au moins j'étais sûr d'y trouver un demi intérêt, mais le truc c'est que j'ai vu une des représentations du Bolchoï diffusées au cinéma... Et c'est juste complètement dingue. Ca m'a fait le même genre d'effet que de regarder l'original muet d'un film que je connaissais. Il m'a beaucoup fait penser à ma première vision de Metropolis restauré, par exemple, mais je vais prendre un exemple plus pop et plus parlant : Frankenstein. Le film de 1931 est un remake d'un film muet de 1910, et le screenplay est sensiblement le même, sauf que ça dit rien, c'est du muet, y a juste une bombarde musicale et des gens qui se meuvent à l'écran. Spartacus en ballet, c'est pareil. L'histoire que j'connais, racontée en mouvements amples et affectés. Et narrativement, c'est un truc de dingue. Y manque rien. Toutes les scènes sont super compréhensibles, les danseurs sont tellement expressifs qu'on ne rate absolument rien de qui fomente un mauvais coup ou qui a peur pour l'autre, et dans le même temps, ça virevolte partout, y a des légionnaires qui font des triples axels, des courtisanes qui font des splits par dessus des esclaves prostrés avec emphase, des bergers qui dansent avec des satyres... C'est... Fascinant, ouaip, j'ai pas d'autre mot. Ca compte pas vraiment, mais c'est pourtant la meilleure expérience que j'ai vécue dans un cinéma cette année.
Mentions
Deux docus bédé, d'abord Hergé : à l'ombre de Tintin, portrait comme son nom l'indique du créateur plutôt que de la créature, ce qui n'est pas arrivé souvent (surtout en comparaison du nombre d'études dédiée au petit reporter), puis Lucky Luke - La fabrique du western européen, dédié quant à lui tant aux auteurs qu'au personnage, et surtout à l'impact du cow boy de Morris sur l'imaginaire franco-belge. Zootopia, fun, joli, attachant, avec un putain de bon sujet et beaucoup de finesse, mais tristement incohérent narrativement - et j'aime pas incohérent dans mon polar, même quand les policiers sont des lapins mignons. Warcraft était carrément bon par rapport à la réputation dégueulasse qui le précédait, mais si le graphisme est réussi et le film clairement compétent (en même temps, fiston Bowie n'est pas un branquignol), c'est quand même très moyennement mon délire. Et j'ai regardé Deadpool, au pif, un aprem' d'ennui - c'est très con, pas très bon, narrativement au ras des pâquerettes, trop long (et pourtant ça dure 1h40), la fin pue du tchul et le cassage de quatrième mur à tout bout de champ c'est vraiment très chiant, mais j'ai rigolé comme un stupide d'un bout à l'autre et j'ai pu prouver à mes yeux et mes oreilles que Ryan Reynolds était bel et bien Deadpool en vrai (si, depuis le début, revoyez son Hannibal King dans Blade 3, c'est sidérant), so i guess, hurray ?
J'ai pas de liste d'attente particulière pour l'an prochain (Blade Runner 2049 et John Wick 2, c'tout), aussi finissons avec un mot sur The Legend of Tarzan, si vous le voulez bien.
Pour citer Winnie l'ourson : "oh, misère." Je voulais que ce film marche. Je voulais tellement que ce film marche. Je l'ai même défendu de certaines accusations que je trouvais étranges avant même de l'avoir vu. D'ailleurs, le voir, j'en avais la frousse, les premières images et l'affiche promotionnelle étaient assez dégueu à mon sens. Mais je voulais qu'il marche, j'étais même prêt à me forcer à l'aimer, tant je voulais qu'il venge John Carter. Et... non. Juste non. Merci, sans façon. Je me souviens qu'à l'issue du premier trailer (décembre 2015 quand même), j'avais écrit deux ou trois impressions, comme Margot Robbie qui ressemblait vraiment à cette Jane désespérément amoureuse, toujours en danger mais loin d'être sans ressource, qui vit dans mon imagination (je ne le répéterai jamais assez, Jane n'est pas une princesse en détresse, c'est une cible pour atteindre Tarzan, elle le sait très bien, et elle s'en fout - c'est même précisément la confiance absolue de Jane qui rend l'image même de Tarzan si puissante), comme le design des singes complètement abusé (genre "miniature du King Kong 2005" abusé), et comme je m'attendais à ce que monsieur Waltz cabotine encore plus que dans James Bond. Le tout baignant dans une imagerie exagérément badass qui donnait salement envie et absolument pas du tout à la fois. Du magnifiquement encourageant et de l'affreusement peu engageant en même temps, quoi. La seule chose que je n'avais pas jugée au préalable, c'était Lord Greystoke ; même après cet encart risible où Samuel L. Jackson l'invective dans un salon, je réservais mon avis. Il m'avait l'air apathique et j'avais peur du syndrome Mad Max Fury Road où il serait le fantôme de son propre film, mais je voulais juger sur pièce. Tout ce qui m'intéressait, c'était que ce soit une aventure autocontenue et de ne surtout pas avoir à vivre une énième origin story...
Au final, j'avais bon sur toute la ligne, en bien comme en mal. Par exemple, Margot Robbie. Margot Robbie est Jane Porter, et c'est le seul point positif du film. The Legend of Tarzan est un récit pulp débridé abracadabrantesque, ce qui n'est pas un mal en soi, mais dont les largesses narratives sont quasi impardonnables (le montage est ignoble, c'est le mec qui a fait les derniers Harry Potter, ça s'voit, et c'est pas un compliment) et dont le graphisme oscille difficilement entre l'absolument fantastique (la réunion avec les lions) et le CG ultra fake dégueulasse (absolument tout le reste). Jackson et Waltz sont deux clowns agaçants qui font des monologues inutiles, Djimon Hounsou, pauvre Djimon Hounsou, est le (sous-)méchant le plus inutile de l'univers, et Alex Skarsgård fait peine à voir en Tarzan constamment ballotté entre fiction et réalité, fatigué par sa propre légende et bien mal servi par l'incapacité du scénario à choisir l'un ou l'autre. C'est... pénible. Pénible en tant qu'amateur du personnage, évidemment, mais surtout en tant qu'amateur de cinéma. Y a des "moments", comme ces quelques secondes de retrouvailles avec les lions, ou ce plan dans la bataille finale où Tarzan rattrape Jane au vol et qu'elle se love dans ses bras quasi-instantanément, mais j'ai l'impression qu'il manque des bouts. Le film ne décolle jamais, et visuellement, c'est d'une tristesse... Les feuilles vertes désaturées et la pluie, ça marchait dans l'approche naturaliste d'Hugh Hudson, mais dans ce film tourné à 99% sur fond vert, c'est laid. Sans compter un rendu tout flou à demi éthéré qui ne rend pas service à la qualité plus que discutable des effets spéciaux et dont la lumière me fait penser à tellement de jeux vidéo aux shaders foireux que c'en serait drôle si ce n'était pas si triste.
Et si encore c'était fun ! Mais non. C'est chiant. Rendez-vous compte, ils ont réussi à rendre Tarzan chiant ! Au début du projet, j'imaginais au moins pouvoir en dire qu'il me faisait le même effet que John Carter, "emportant inconditionnellement mon adhésion malgré ses défauts", et c'était probablement le meilleur compliment que je pouvais lui faire, mais je refuse d'insulter John Carter avec ce film. Il l'a bel et bien vengé au box office, mais qualitativement... The Legend of Tarzan est un immense gâchis, un gâchis que je place au même rang que -tiens, tiens- le Mad Max de l'an dernier : des persos que j'adore, un bon cast, quelques chouettes images, mais un film narrativement effroyable, sans âme, creux en contenu, qui pue le fake de synthèse et se révèle au final juste désespérément, tristement et irrémédiablement... mauvais. Je suis amère déception.
Inscription à :
Articles (Atom)